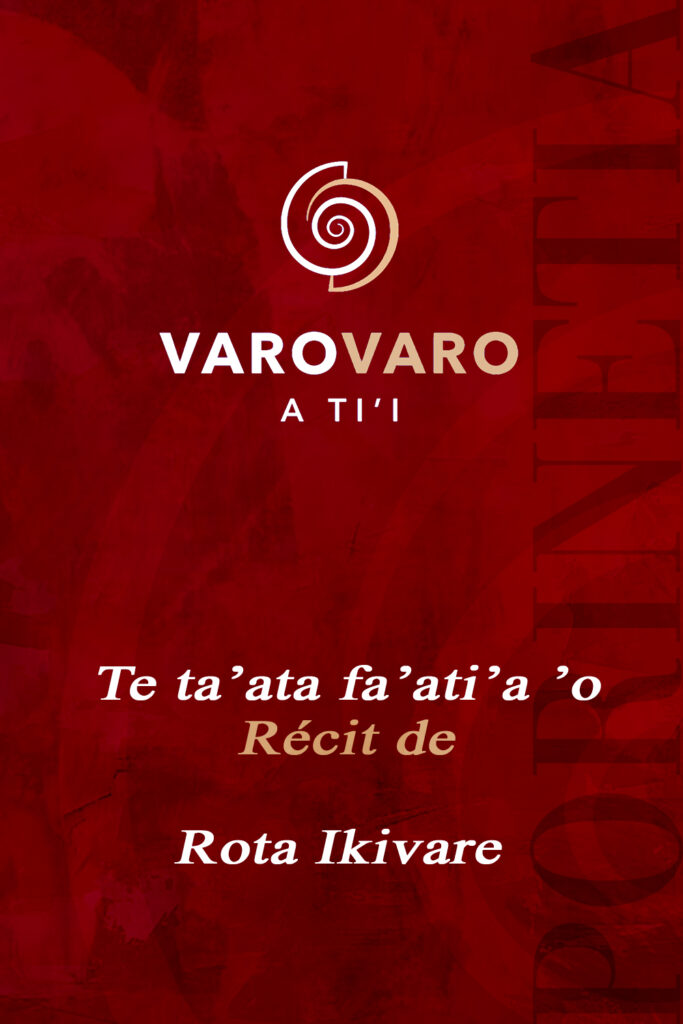
Ha'a-poto-ra'a-parau
Tē fa'a'ite mai ra 'oia i te i'oa o tōna nā metua fānau, nō Raroto'a ho'i te metua tāne 'e nō Porapora te metua vahine, 'ua fa'a'amuhia rā 'ōna. E piti matahiti tōna te pohera'a tōna māmā i te ma'i rahi i tupu i te matahiti 1918. Tē fa'ati'a nei 'oia i te mata'i rahi i tupu i Porapora i te matahiti 1926, e mea pāpū maita'i iāna te reira. 'Ua nīnāhia te fenua. E mea ha'apou te fare i te reira tau i Porapora. E toru rātou, hō'ē tamaroa, e piti tamahine, 'e 'ōna ho'i tō rātou hōpe'a. 'Ua fa'aea i te ha'api'ira'a i te 'ahuru ma ono o te matahiti, 'e tē fa'ahiti nei 'oia i te mau 'ohipa i ha'api'ihia i te fare ha'api'ira'a. E fa'atito vānira te 'ohipa. E 'ohihia na te vānira i te 'āva'e māti nō te ho'o atu i te 'ona tinitō. Te moni kiro o te vānira i te reira tau. Tē vai nei te tōmite e fa'aara i te taime tāpūra'a vānira. E rama i te i'a i te pō.
Descriptif de l'interview
Rota Ikivare mentionne les noms de ses parents : son père était originaire des îles Cook et sa mère de Borabora. Elle avait été adoptée. Sa mère est décédée de la grippe espagnole alors qu’elle n’avait que deux ans. Elle se souvient avec précision du cyclone qui a frappé Borabora en 1926, submergeant l’île. À cette époque, les maisons étaient construites sur pilotis. Issue d’une fratrie de trois enfants — un frère et deux sœurs — elle en était la benjamine. Elle a quitté l’école à l’âge de 16 ans et se rappelle les enseignements qu’on y recevait. Elle cultivait la vanille, dont la récolte avait lieu en mars, avant d’être vendue aux commerçants chinois. Le prix du kilo variait selon la période. Un comité local avertissait les cultivateurs lorsque le moment était venu de couper les gousses. Elle raconte aussi les sorties de pêche nocturne, éclairées à la torche.
Te mau vāhi i fa'ahitihia / Lieux évoqués : Raroto'a, Vairupe, Amanahune, Fa'anui, 'Ānau, Temanuititaurauraau, Faretai, Farero, Vaitāpē, Porapora, Uturoa, Avera, Ra'iātea, Maupiti, Rurutu, Māhina, Papara, Papeari, Tahiti, Makatea.
Tafai Teaotea, e ta'ata tumu nō Nunu'e i te fenua nō Bora Bora.
E uiuira'a mana'o tei tupu i Tiipoto i te fenua nō Bora Bora.
Tafai Teaotea est originaire de Nunu'e sur l'île de Bora Bora.
Interview réalisée à Tiipoto sur l'île de Bora Bora.
Matahiti fānaura'a o te ta'ata fa'ati'a : 1916
Année de naissance de la personne source : 1916
Te mau reo / Langues : Reo tahiti
Te ta’ata fa’ati’a / Récit de Rota Ikivare
'Ua fa'atupuhia tōna fa'aipoipora'a i te tahi fare 'āmuira'a nō Nu'uhiva i te 2 nō 'ēperera 1938, e ahimā'a tei fa'anahohia nō te reira mahana. Tē fa'a'ite mai ra 'oia i te huru tunura'a o te taro 'āpura a tō Nu'uhiva. E ono matahiti tō rāua fa'aeara'a i reira. Tē fa'ati'a nei 'oia i tō rāua ōra'a i te 'āua pipi. E piti tāna tamari'i, hō'ē tamāroa tei pohe, hō'ē tamāhine tē ora nei ā i teie mahana. I tonohia na te tahi tuati ma'i, 'o Tera'i te i'oa, nā Tahiti mai nō te 'āpe'e i te mau fānaura'a i Nu'uhiva. 'Ua tonohia rāua i Vaitāpē, e piti 'ahuru matahiti tō rāua fa'aeara'a i taua mata'eina'a nō Porapora, mai te matahiti 1948 'e tae atu i te matahiti 1976, tō rāua ato'a ïa fa'atuha'ara'a 'ia au i tō rāua ti'ara'a 'orometua. Tē fa'a'ite mai ra 'oia i te mau 'ohipa tā rāua i rave nō te maita'i o te orara'a pāroita i reira rāua i te tāvinira'a. Nā te 'orometua Teuiara'i i ha'apao mai na i te pāroita nō Fa'anui, 'oia te tamaiti a Mehao. Terā rā, i terā ra tau, 'aita tō Porapora e fa'ari'i nei hau atu i te hō'ē 'orometua i tōna fenua, e'ita ato'a rātou e fa'ari'i nei i te feiā 'e'ē 'ia tonohia atu i reira. 'Ua pararī te patura'a mātāmua o te fare pure i te hō'ē mata'i rorofa'i. Tē fa'ahiti nei 'oia i te parau 'o Puahio, te 'orometua porotetani mātāmua i tae i Porapora, o tāna ato'a i 'ite-mata roa. 'Aita 'ōna i 'ite ia Marakai, inaha ho'i nō mua roa atu 'ōna. 'Ua fa'a'ohipahia te pu'a nō te patu i te fare purera'a 'āpī, te fa'anahora'a nō te tomora'a i te fare purera'a 'āpī, e fa'ari'ihia te mau manihini nō Tahiti i ni'a i te māhora.
La cérémonie de mariage se déroula dans une maison paroissiale aux Marquises, le 2 avril 1938. Pour l’occasion, un four traditionnel fut préparé. Elle décrit comment les Marquisiens cuisinaient une variété de taro appelée 'āpura. Le couple vécut aux Marquises pendant six ans. Elle raconte également leur entrée à l’école pastorale. Elle eut deux enfants : un garçon, aujourd’hui décédé, et une fille, toujours en vie. À cette époque, un aide-soignant tahitien nommé Tera’i avait été envoyé aux Marquises pour assister les femmes lors des accouchements. En 1948, ils furent envoyés à Vaitāpē, dans le district de Borabora, où ils vécurent pendant vingt ans, jusqu’en 1976. C’est là qu’ils prirent leur retraite de pasteur. Elle évoque les nombreuses actions qu’ils menèrent pour améliorer la vie de la paroisse. Teuiara’i, fils de Mehao, était alors pasteur à Fa'anui. À cette époque, il n’était pas courant — ni accepté — d’avoir deux pasteurs en poste à Borabora, ni que des personnes venues de l’extérieur soient affectées à l’île. La première construction du temple avait été détruite par un cyclone. Elle se souvient de Puahio, l’un des tout premiers pasteurs protestants arrivé à Borabora, dont elle connaissait le visage. Elle n’avait pas connu Marakai, qui lui était bien antérieur. Pour bâtir le nouveau temple, les habitants utilisèrent du corail. Elle raconte l’organisation de son inauguration : les invités venus de Tahiti furent accueillis solennellement sur la place du village.
I tae ai rāua i Porapora, e mea nā ni'a ïa i tō rāua ti'ara'a 'orometua. Tau fare 'āmuira'a tei fa'ati'ahia i tō rāua tau. 'Ei 'imira'a faufa'a nā te mau 'āmuira'a, e tuha'a 'ohipa nā te mau vahine te 'ohira'a huero ti'a'iri nā ni'a i te mou'a, tūpa'ipa'ihia atu ai taua mau huero hou 'a tuihia ai nō te ho'o. Tē fa'ati'a ato'a nei 'oia i te pe'ape'a i tupu i rotopū i te mau 'orometua i mua i te parau o te fa'aterera'a o te 'āmuira'a Hātai. I teie nei rā 'ua fa'atuha'ahia rāua.
Le couple était venu à Borabora en tant que pasteurs. Elle évoque les maisons paroissiales qui avaient été construites durant leur mandat pastoral sur l’île. Les femmes se rendaient en montagne pour ramasser des graines de bancouliers (ti'a'iri), elles cassaient ensuite les graines qu'elles enfilaient en colliers afin de les vendre. L'argent ainsi récolté était destiné à financer les besoins des groupes paroissiaux. Elle raconte également les tensions survenues entre les pasteurs au sujet de la direction du groupe paroissial de Hatai.
Te mau rāve'a / Données techniques
Papa mātāmua / Support original : Cassette audio
Ta'ata-uiui / Collecteur : Manolita Pahuiri
Ta'ata pāpa'i parau / Rédacteur de la fiche : Fabiola Itchner
Tāpa'o-niu / Cote : SEE0013 / SEE0014 / VAT089
Maorora'a / Durée : 56 miniti / minutes
Matahiti huihuira'a / Année de collecte : 1986
Faufa'a ha'aputu nō / Fonds : PSPE – Programme de Sauvetage du Patrimoine Ethnographique
Te ha'a nūmerara'a 'e te fa'a'ohipara'a i te haruharura'a parau tumu / Numérisation et traitement de l'enregistrement original : Tuhiva Lambert

