
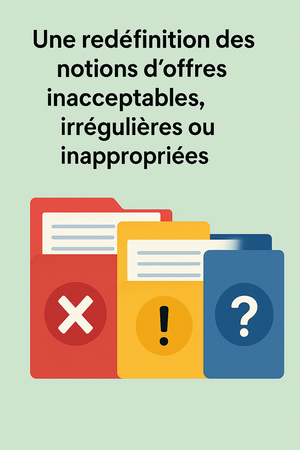
Une redéfinition des notions d’offres irrégulières, inacceptables et inappropriées
Code polynésien des marchés publics
- Article LP 122-3 (modifié par l’article LP 1 de la loi du pays n° 2025-XX du XX juillet 2025) :
9° offre inacceptable, offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ;
10° offre inappropriée, offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation ;
11° offre irrégulière, offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ;
L’article LP 1 de la la loi du pays n° 2015-XX du juillet a fait évoluer les notions d’offres irrégulières, inacceptables et inappropriées définies aux points 9°, 10°, 11° de l’article LP122-3 du Code polynésien des marchés publics (CPMP) afin d’aligner leurs définitions sur le droit national.
Objectif de la réforme : Clarifier ces notions pour sécuriser juridiquement l’analyse des offres des candidats et harmoniser la pratique locale avec la doctrine et la jurisprudence nationales. Les nouvelles définitions permettent aux acheteurs publics polynésiens de s’appuyer sur la doctrine administrative mais également sur la jurisprudence du Conseil d’État, pour interpréter ces concepts. Elles distinguent mieux les cas où une offre peut être écartée d’une procédure de marché public (ou au contraire régularisée), tout en encadrant la capacité de l’acheteur public à accepter ou refuser certaines offres.
Ancienne définition (avant 2025) – Une offre irrégulière était définie comme « offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ». Cette rédaction insistait sur le caractère incomplet ou non-conforme aux exigences formulées dans le dossier de consultation, sous-entendant qu’une offre irrégulière répondait tout de même au besoin (à la différence d’une offre inappropriée).
Nouvelle définition (2025) – Désormais, l’article LP 122-3 11° dispose qu’une offre irrégulière est une offre « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». La nouveauté majeure est l’ajout de la non-conformité à la législation (sociale, environnementale, fiscale, droit du travail, etc.) comme cause d’irrégularité de l’offre. Autrement dit, une offre qui violerait une loi ou une réglementation applicable au marché (par exemple en proposant des conditions de rémunération de ses salariés ne respectant pas le code du travail polynésien ) est dorénavant irrégulière, alors que l’ancien texte classait ce cas parmi les offres « inacceptables ».
Portée de la nouvelle définition : L’offre irrégulière englobe désormais deux grands types de manquements :
- Non-respect des exigences du dossier de consultation – Par exemple, le fait de ne pas respecter une clause technique impérative du cahier des charges, de présenter une offre comportant des contradictions empêchant de vérifier sa conformité, ou encore de ne pas suivre le formalisme imposé (oubli de chiffrer une rubrique du bordereau de prix, etc.) rend l’offre irrégulière. Une offre incomplète (pièce ou renseignement obligatoire manquant) entre également dans cette catégorie. Ainsi, une offre dont il manque un prix unitaire obligatoire a été jugée irrégulières par le juge administratif. En revanche, une offre ne sera pas qualifiée d’irrégulière pour le seul motif qu’elle propose un prix inférieur à un minimum indicatif prévu au règlement (le Conseil d’État a jugé qu’un prix plus bas qu’un montant indicatif n’était pas, en soi, une entorse aux exigences du dossier). De même, l’absence d’un document non expressément requis à peine d’irrégularité ne justifie pas l’élimination de l’offre – il convient de distinguer les éléments indispensables (dont l’absence rend l’offre inacceptable ou irrégulière) des éléments simplement utiles à l’évaluation, dont l’omission peut être sanctionnée par une note zéro plutôt que par un rejet.
- Méconnaissance de la législation en vigueur – C’est la nouveauté textuelle par rapport à l’ancienne définition de l’offre irrégulière : si une offre propose des conditions contraires aux obligations légales, par exemple ne respecte pas la réglementation sociale (salaire minimum, conventions collectives) ou environnementale applicable, elle doit être considérée comme irrégulière. Il en va de même pour une offre méconnaissant d’autres dispositions impératives (règles de sous-traitance, fiscalité, etc.). Exemple : le Conseil d’État a jugé qu’une offre proposant un prix de vente de livres méconnaissant la loi Lang sur le prix unique du livre était irrégulière. De même, une offre ne respectant pas les stipulations obligatoires d’une convention collective applicable au marché a été considérée comme irrégulière.
Ancienne définition – Avant la réforme de 2025, l’article LP 122-3 9° définissait une offre inacceptable comme « une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la réglementation en vigueur, ou [une offre] pour laquelle les crédits budgétaires alloués au marché, après évaluation du besoin à satisfaire, ne permettent pas à l’acheteur public de la financer ». Cette ancienne rédaction mélangeait deux notions distinctes : (1) l’offre dont l’exécution violerait la réglementation (aspect désormais transféré à l’irrégularité, cf. supra) et (2) l’offre financièrement hors budget disponible.
Nouvelle définition – Désormais, le 9° de l’article LP 122-3 vise uniquement la question budgétaire. Une offre inacceptable est « une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Ainsi, seule l’hypothèse d’une offre au-delà de l’enveloppe financière préalablement fixée par l’acheteur est retenue pour qualifier l’offre d’inacceptable. La référence aux “conditions d’exécution méconnaissant la réglementation” a été supprimée (car relevant désormais de l’offre irrégulière).
Portée de la notion : Une offre inacceptable est donc une offre financièrement irrecevable, car non financée par le budget prévu pour le marché. L’acheteur public a l’obligation, avant de lancer sa procédure, de provisionner de façon sincère et précise les crédits nécessaires pour chaque marché ou chaque lot. Si le prix d’une offre dépasse ces crédits alloués, l’offre est inacceptable et doit être écartée. Il s’agit d’une protection pour l’acheteur : ne pas s’engager dans un contrat qu’il n’aurait pas les moyens de payer.
Cependant, la jurisprudence administrative encadre strictement cette notion pour éviter qu’un acheteur public élimine abusivement une offre jugée trop onéreuse. Quelques principes jurisprudentiels à retenir :
- Budget alloué vs. estimation du coût : Ce n’est pas parce qu’une offre dépasse l’estimation initiale du marché qu’elle est forcément inacceptable. Le Conseil d’État a jugé que « la seule circonstance qu’une offre soit supérieure au montant estimé par l’acheteur ne suffit pas » à la qualifier d’inacceptable. Ce qui compte, c’est si l’offre peut ou non être financée par les crédits disponibles. En d’autres termes, si le montant de l’offre reste compatible avec le budget de l’acheteur, celui-ci est tenu de l’accepter, même si le prix dépasse son estimation interne. L’acheteur n’a pas le droit de rejeter une offre financée au motif qu’il la juge “trop chère” par rapport à son évaluation, dès lors qu’il dispose des crédits pour y faire face.
- Crédits budgétés préalables et sincères : La notion d’offre inacceptable se rapporte aux crédits spécifiquement alloués au marché avant la procédure, et non au budget annuel global de l’acheteur. La doctrine administrative française a ainsi précisé que l’inacceptabilité « ne renvoie ni à la notion de budget annuel de l’administration, ni à une opération globale », mais seulement aux crédits affectés « pour chaque achat et chaque lot » de manière sincère et fiable avant de lancer l’appel d’offres. En pratique, il est fortement recommandé aux acheteurs de bien déterminer et ventiler les crédits par lot le cas échéant, afin de pouvoir identifier clairement une offre excédant l’enveloppe de ce lot.
- Exemples jurisprudentiels : Une offre dépassant de 25 % l’estimation du marché n’est pas inacceptable si l’acheteur avait les crédits suffisants pour l’accepter (le juge exige de prouver l’impossibilité financière, pas le simple écart au prévisionnel). En revanche, une offre dont le prix excède le budget alloué à un lot déterminé est bien inacceptable. Ainsi, dans un marché alloti, si le candidat propose un prix pour le lot n°X qui excède l’enveloppe prévue pour ce lot, l’acheteur peut écarter cette offre comme inacceptable. À l’inverse, si l’acheteur a indiqué une « enveloppe financière » purement indicative (non formellement arrêtée), une offre la dépassant ne saurait être automatiquement jugée inacceptable – le juge vérifiera si cette enveloppe avait ou non un caractère contraignant.
En somme, la réforme 2025 resserre la notion d’offre inacceptable sur le seul critère budgétaire. Pour l’acheteur public polynésien, cela clarifie que : est inacceptable l’offre dont le financement dépasse les crédits disponibles prévus. Dans tous les autres cas, l’offre devra être analysée autrement (offre irrégulière si non-conforme mais pas “inacceptable” si elle peut être financée).
Comme pour les offres irrégulières, une offre inacceptable peut, si la procédure le permet, être régularisée en cours de négociation (notamment en adaptant son prix si le candidat accepte de revoir son offre à la baisse). Mais en procédure sans négociation, une offre dépassant le budget doit être éliminée sans discussion possible. Si toutes les offres reçues sur un marché sont inacceptables (toutes au-dessus des crédits), l’acheteur devra soit revoir son besoin/budget, soit déclarer la procédure infructueuse et éventuellement la relancer sous une autre forme (éventuellement en passant en procédure négociée sans publicité si les conditions réglementaires sont réunies, à l’instar du droit français qui l’autorise dans un cas d’échec d’appel d’offres pour offres inacceptables ou irrégulières).
Définition inchangée dans le fond – La notion d’offre inappropriée est restée sensiblement la même, bien que sa formulation ait été précisée en 2025. Avant la réforme, l’article LP 122-3 10° décrivait une offre inappropriée comme « une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin de l’acheteur public et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre ». Après la réforme, le 10° prévoit qu’une offre inappropriée est une « offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation ». On le voit, la nouvelle rédaction reprend l’idée directrice (offre “sans rapport” avec le besoin), en y ajoutant une explication : l’offre ne pourrait répondre au besoin qu’au prix de modifications profondes. Cette précision souligne qu’une offre inappropriée est fondamentalement hors sujet.
Portée de la notion : Une offre inappropriée est assimilée à l’absence même d’offre valable de la part du candidat. La Direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Économie française l’exprime ainsi : une offre inappropriée peut être considérée comme inexistante « dans la mesure où elle ne répond pas à la solution technique et administrative définie par l’acheteur public et […] ne correspond pas à son besoin ». En pratique, cela vise les offres complètement à côté du cahier des charges : le candidat propose quelque chose qui ne réalise pas l’objet du marché ou ne respecte pas du tout les spécifications essentielles.
- Exemples concrets d’offres inappropriées :
- Une offre proposant un produit/service radicalement différent de la demande. Exemple réel : pour un marché portant sur des rétroviseurs avec bras, une offre proposant des rétroviseurs sans bras a été jugée inappropriée, car ne répondant pas à la spécification essentielle attendue. De même, si un appel d’offres demande un logiciel de gestion et qu’un candidat propose uniquement du matériel informatique, son offre serait “hors sujet” et donc inappropriée.
- Frontière entre offre inappropriée et offre irrégulière : Elle peut parfois être subtile, mais est cruciale. Retenons qu’une offre inappropriée ne permet pas du tout de satisfaire le besoin, alors qu’une offre irrégulière apporte une ébauche de réponse (encore faut-il qu’elle respecte a minima l’objet du marché). Le critère déterminant est la possibilité de régularisation : une offre inappropriée étant hors sujet, la corriger impliquerait de la modifier sur le fond (changer la solution proposée), ce qui est interdit en cours de procédure (principe d’intangibilité des offres). C’est pourquoi les offres inappropriées doivent être éliminées d’office et ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation. Le Code polynésien prévoit explicitement que les offres inappropriées sont éliminées et ne peuvent pas être complétées ou négociées. Permettre la régularisation d’une offre inappropriée reviendrait à accepter qu’un candidat modifie substantiellement son offre en cours de route, en violation du principe d’égalité. À l’inverse, les offres irrégulières peuvent, comme vu précédemment, faire l’objet de correctifs ou d’améliorations tant que cela ne bouleverse pas les caractéristiques essentielles de l’offre initiale.
En résumé, la réforme n’a pas changé le fond de cette notion : une offre inappropriée est une offre qui ne correspond pas du tout au besoin, et l’acheteur public doit l’écarter comme nulle et non avenue. Pour les acheteurs, identifier une offre inappropriée revient à se demander : « si je devais accepter cette offre, répondrait-elle à mon besoin sans devoir la transformer ? ». Si la réponse est non (offre hors sujet, inapte à remplir l’objet du marché), elle est à éliminer pour inappropriée. Notons que si toutes les offres reçues sont inappropriées (aucune ne correspond au cahier des charges), l’acheteur se retrouve en situation d’appel d’offres infructueux faute d’offre exploitable – ce qui peut justifier de revoir la formulation du besoin ou de recourir à une procédure négociée après appel d’offres infructueux, conformément aux possibilités offertes par la réglementation.
- Alignement sur les définitions nationales : Les acheteurs publics polynésiens pourront s’appuyer sur la doctrine et jurisprudence françaises accumulées sur ces notions pour qualifier les offres d’irrégulières, d’inacceptables ou d’inappropriées. Par exemple, pour savoir si un manquement mineur rend une offre irrégulière ou non, ils peuvent se référer aux décisions du Conseil d’État. Cet alignement facilite également la formation des agents acheteurs et la compréhension commune des termes par les opérateurs économiques. In fine, cela contribue à une sécurité juridique et à une égalité de traitement accrues.
- Adaptation des documents de consultation : Du point de vue pratique, les acheteurs publics ont intérêt à tirer parti de ces définitions lors de la préparation de leurs dossiers :
- Exigences clairement formulées – Étant donné qu’une offre qui ne respecte pas les exigences du DCE sera écartée comme irrégulière, il est crucial de bien indiquer quelles clauses ou documents sont obligatoires (sous peine d’irrégularité de l’offre). Le règlement de consultation doit être explicite sur les pièces à fournir impérativement, les critères éliminatoires, etc., afin d’éviter toute ambiguïté. Une exigence obscure ou sans utilité risque d’être relativisée par le juge, donc mieux vaut ne demander que ce qui est pertinent et savoir faire preuve de proportionnalité.
- Estimation et budget prévisionnel – La notion d’offre inacceptable implique de prédéterminer sérieusement le budget du marché. Les acheteurs doivent estimer au plus juste le coût de l’opération et obtenir l’engagement de crédits correspondants avant de lancer la procédure. Ils veilleront à ventiler par lot le cas échéant. Cette discipline budgétaire permet, le moment venu, de justifier qu’une offre est au-delà de l’enveloppe disponible. À noter qu’en cas d’offre financièrement élevée, l’acheteur peut aussi réfléchir à adapter son besoin (quantités, exigences) ou à rechercher des financements complémentaires plutôt que d’éliminer l’offre – mais s’il ne peut ajuster son budget, l’offre devra être écartée.
En conclusion, la loi du Pays 2025 consacre une évolution juridique importante pour la commande publique polynésienne : les notions d’offres irrégulières, inacceptables, inappropriées sont désormais alignées sur le droit national. Cette évolution permet aux acheteurs publics polynésiens d’améliorer le traitement des offres et la motivation de leurs décisions, tout en bénéficiant de l’apport de la doctrine et de la jurisprudence métropolitaines accumulées sur ces sujets. Il en résulte une plus grande transparence et efficacité dans l’achat public, au service de l’égalité d’accès à la commande publique et de la bonne utilisation des deniers publics.
