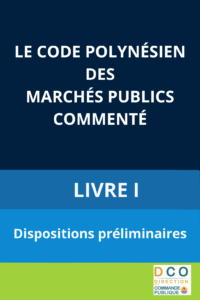LIVRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
PARTIE LOI DU PAYS
PARTIE ARRETE
TITRE Ier – PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre unique
Les marchés publics de la Polynésie française, de ses établissements publics, des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont soumis au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics conformément aux articles 28-1 et 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
Ces principes sont mis en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code.
TITRE II – CHAMP D’APPLICATION
Chapitre Ier – Personnes morales de droit public soumises au code
Les acheteurs publics soumis au présent code sont les personnes morales de droit public suivantes :
1° La Polynésie française et ses établissements publics ;
2° Les communes de la Polynésie française, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française.
Le présent code s’applique également aux personnes agissant dans le cadre d’un mandat donné par l’une des personnes morales de droit public mentionnées au 1° et au 2°.
1. Les acheteurs publics polynésiens soumis au CPMP
Le code polynésien des marchés publics (CPMP) substitue la notion « d’acheteur public » à celle de « personne publique » qui prévalait dans la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics.
Les catégories d’acheteurs publics polynésiens auxquelles s’appliquent désormais les nouvelles règles des marchés publics sont fixées à l’article LP 121-1.
Parmi celles-ci figurent, outre la Polynésie française et ses établissements publics administratifs déjà soumis à l’ancien code :
– les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) de la Polynésie française ;
– les communes polynésiennes, leurs établissements publics (EPA et EPIC), leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou encore leurs syndicats mixtes.
2. Les mandataires des acheteurs publics polynésiens sont également soumis au CPMP
Le dernier alinéa de l’article LP 121-1 reprend un principe dégagé par plusieurs décisions de jurisprudence. Les marchés passés en exécution d’un mandat par le mandataire d’une collectivité publique soumise au code des marchés publics sont assujettis aux dispositions du code des marchés publics.
Cet article vise en particulier les mandats de maîtrise d’ouvrage délégué. Le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant ce qui implique les conséquences suivantes:
– les actes accomplis par le mandataire (maître d’ouvrage délégué), en vertu du mandat, engagent le mandant (maître d’ouvrage) comme s’il les avait accomplis lui-même ;
– le mandataire applique les obligations qui s’imposeraient au maître d’ouvrage, son mandant, comme si ce dernier agissait lui-même (par exemple, le mandataire applique les règles du code polynésien des marchés publics si le maître d’ouvrage y est assujetti) ;
– le mandataire rend compte au maître d’ouvrage de ce qu’il a fait en son nom ;
– les tiers (par exemple, les entreprises) avec lesquels le mandataire contracte, au nom du maître d’ouvrage, sont responsables contractuellement envers le maitre d’ouvrage et non envers le mandataire;
– le mandataire n’est pas responsable envers le maître d’ouvrage des obligations des tiers, mais seulement des attributions qui lui ont été confiées personnellement.
Enfin, il convient également de relever que le contrat passé, à titre onéreux, entre un acheteur public et un mandataire est un contrat de services soumis au code des marchés publics, à l’exception du cas ou les parties sont dans une relation susceptible d’être qualifiée de « in house » (voir sur ce point les commentaires sous l’article LP 123-1).
Chapitre II – Définitions
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur public et un opérateur économique public ou privé tel que défini à l’article LP 122-3, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Au sens du présent code, les contrats de travail ne sont pas des marchés publics.
I – Les marchés publics de travaux ont pour objet soit l’exécution, soit la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par l’acheteur public qui en exerce la maîtrise d’ouvrage.
II – Les marchés publics de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de biens meubles.
III – Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.
IV – Lorsqu’un marché public comporte des travaux, des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Lorsqu’un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu’un marché public a pour objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation de celles-ci, il est considéré comme un marché de fournitures.
Au sens du présent code, on entend par :
1° artisan, les personnes physiques ou morales travaillant à façon qui exercent à titre principal une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services et qui n’emploient pas plus de cinq salariés ;
2° autorité compétente, l’autorité habilitée, au nom de l’acheteur public, à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des marchés ;
3° avenant, acte contractuel par lequel les parties à un marché modifient ou complètent une ou plusieurs de leurs clauses ;
4° décision de poursuivre, acte unilatéral émanant de l’acheteur public qui a pour objet de permettre l’exécution des prestations au-delà du montant initial prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe ;
5° lot, une décomposition des besoins de l’acheteur public en unités de prestations autonomes pouvant être attribuées séparément et déterminées notamment en fonction de critères tenant aux caractéristiques techniques des prestations, à la structure du secteur économique en cause, des règles encadrant l’exercice de certaines professions ou du lieu d’exécution ;
6° maître d’œuvre, la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, d’apporter une réponse architecturale, technique ou économique au programme défini par le maître de l’ouvrage, de diriger l’exécution des travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
7° maître de l’ouvrage, la personne morale pour le compte de laquelle l’ouvrage est construit et qui soit assure la direction technique des actions de construction, soit devient propriétaire de l’ouvrage à la date de son achèvement ;
8° marché industriel, un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l’acheteur public ;
9° offre inacceptable, offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ;
10° offre inappropriée, offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation ;
11° offre irrégulière, offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ;
11° bis offre anormalement basse, offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
12° opérateur économique, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé ou de droit public, ou tout groupement de ces personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;
13° ouvrage, le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique
14° prestations supplémentaires éventuelles, des prestations obligatoires ou facultatives demandées aux candidats par l’acheteur public dont les spécifications sont définies au cahier des charges et que l’acheteur se réserve la possibilité de commander ou non ;
15° programme de l’opération, le document dans lequel le maître de l’ouvrage définit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage ;
16° sous-traitant, la personne physique ou morale, chargée par le titulaire du marché de réaliser, sous sa responsabilité, certaines parties du marché qu’il a conclu avec l’acheteur public ;
17° titulaire du marché, l’opérateur économique qui conclut le marché avec l’autorité compétente de l’acheteur public et en assure l’exécution ;
18° variante, des modifications à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
1. Un marché public est un contrat
L’article LP 122-1 du CPMP définit la notion de marchés publics.
Un marché public est avant tout un contrat, c’est-à-dire un acte synallagmatique ou bilatéral consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, par lequel les deux parties vont s’obliger réciproquement, l’une dans l’exécution de prestations, l’autre dans le paiement du prix. Cette notion s’oppose à celle d’acte unilatéral telle qu’une subvention allouée par une personne publique.
Les marchés publics ne doivent pas être confondus avec d’autres contrats relevant de régimes juridiques différents (contrats de travail, délégations de service public, baux emphytéotiques administratifs…).
2. Un marché public a pour objet de répondre aux besoins de l’acheteur public en matière de fournitures, de services et de travaux
Les marchés publics ont pour objet de répondre aux besoins des acheteurs publics en matière de fournitures, de services et de travaux. Ces différentes catégories de marchés sont définies à l’article LP 122-2.
3. Un marché public est conclu à titre onéreux
Les prestations servies par l’opérateur économique doivent être effectuées en contrepartie d’un prix. Lorsque la rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation d’un service ou d’un ouvrage, le contrat ne peut être qualifié de marché public.
Dans la majorité des cas, le marché donne lieu au versement d’une somme d’argent par la personne publique. Lorsque l’administration bénéficie de prestations et que le versement effectué peut être regardé comme leur contrepartie, il constitue un prix, quelle que soit la qualification donnée par les parties : une subvention peut ainsi être requalifiée en prix et le contrat en marché. Le prix n’est pas nécessairement payé par l’acheteur. Le caractère onéreux peut, en effet, résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une recette née à l’occasion de l’exécution du marché. Il s’agira, par exemple d’un marché d’édition d’un bulletin municipal lorsque la rémunération du prestataire est liée aux recettes publicitaires qui en sont issues (CE, 10 février 2010, Société Prest’Action, n° 301116).
4. Un marché public est conclu avec un opérateur économique public ou privé
Le cocontractant de l’acheteur public doit être un opérateur économique, c’est-à-dire une entité, quel que soit son statut juridique (SA, SARL, EURL, patenté etc.) et son mode de financement, qui exerce une activité économique. Le Conseil d’État a jugé que les collectivités publiques peuvent ne pas passer un marché public « lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel » (CE Section, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n° 284736). Certaines commandes, à caractère social en particulier, peuvent ainsi être passées avec des organismes qui, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions dans lesquelles ils agissent, ne peuvent être regardés comme des opérateurs économiques. Le contrat éventuel qui les lie alors à la collectivité ne peut être analysé comme un marché public.
Une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un marché public. Toutefois, les modalités d’intervention de la personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre celle-ci et les autres entreprises, afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique et le droit de la concurrence. La personne publique, qui soumissionne, devra donc être en mesure de justifier, le cas échéant, que le prix proposé a été déterminé, en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour déterminer ce prix, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public (CE, avis, 8 novembre 2000, Sté Jean-Louis Bernard consultants, n° 222208).
5. Les contrats de travail ne sont pas des marchés publics
Le dernier alinéa de l’article LP 122-1 indique que les contrats de travail ne sont pas des marchés publics. Il convient toutefois de préciser que les contrats conclus par des acheteurs publics avec des entreprises d’intérim ou des cabinets de recrutement ne sont pas exclus du champ d’application du CPMP. Ils s’analysent comme des marchés de services de travail temporaire et sont en conséquence soumis au code polynésien des marchés publics.
6. Les marchés publics sont des contrats administratifs
En vertu des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifié par l’article 66 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, tous les contrats soumis au code polynésien des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. En conséquence, les litiges relatifs à leur passation ou leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif.
Chapitre III – Exclusions
Section 1 – Exclusions à raison de la qualité de l’opérateur
I – Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux marchés publics attribués par un acheteur public à une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L’acheteur public exerce sur la personne morale concernée, seul ou conjointement avec d’autres acheteurs publics, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ou qu’ils exercent sur leurs propres services ;
2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le ou les acheteurs publics qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes acheteurs publics ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi ou les règlements qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Les modalités d’exercice du contrôle analogue ou conjoint évoqués au 1° et les modalités d’appréciation du pourcentage d’activité mentionné au 2° sont déterminées dans les conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres.
II – Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux marchés publics attribués par une personne morale soumise au présent code à une autre personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les deux personnes morales sont soumises au contrôle analogue d’un même acheteur public ;
2° La personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi ou les règlements qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée
III – Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux marchés publics de services conclus avec un autre acheteur public lorsque ce dernier bénéficie, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif.
Au sens du 1° du I de l’article LP 123-1 :
L’acheteur public est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.
Les acheteurs publics sont réputés exercer un contrôle analogue conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les acheteurs publics participants, une même personne pouvant représenter plusieurs acheteurs publics participants ou l’ensemble d’entre eux ;
b) Ces acheteurs publics sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée;
c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des acheteurs publics qui la contrôlent.
Le pourcentage d’activités mentionné au 2° du I de l’article LP 123-1 est déterminé en prenant en compte le chiffre d’affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tels que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l’attribution du marché public.
Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d’activités est déterminé sur la base d’une estimation réaliste.
Aux termes de l’article LP 123-1 du CPMP, certains contrats conclus entre entités appartenant au secteur public, constituant des contrats de quasi-régie également qualifiés de contrats « in house », sont exclus du champ d’application du code polynésien des marchés publics. Cette exclusion concerne tous les contrats de fournitures, de travaux ou de services conclus entre deux personnes morales distinctes, mais dont l’une peut être regardée comme le prolongement administratif de l’autre.
L’article LP 123-1 distingue deux types de contrats de quasi-régie :
– le contrat de quasi-régie vertical (Article LP 123-1 I)
– le contrat de quasi-régie horizontal (Article LP 123-1 II)
1. Les critères de qualification du contrat de quasi régie vertical
La mise en oeuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de marchés entre un acheteur public et une personne morale de droit public ou de droit privé, n’est pas nécessaire lorsque trois conditions, qui sont cumulatives, sont remplies :
– le contrôle exercé par le ou les acheteurs publics sur le cocontractant doit être comparable à celui qu’ils exercent respectivement sur leurs propres services ;
– la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le ou les acheteurs publics qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes acheteurs publics ;
– la personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de capitaux privés.
1.1 L’acheteur public doit exercer sur son cocontractant, seul ou conjointement avec d’autres acheteurs publics, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ou qu’ils exercent sur leurs propres services.
L’article A 123-1 du CPMP définit la notion de contrôle analogue. Ainsi, « un acheteur public est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée ».
Selon la jurisprudence européenne dont est issue la notion de contrats « in house » reprise dans le CPMP, si la détention du capital d’une personne morale par un acheteur public à hauteur de 100% constitue un indice du contrôle analogue, cela ne s’avère toutefois pas suffisant (CJUE, 11 mai 2006, Carbotermo SpA, C-340/04).
L’existence d’un contrôle analogue doit, en outre, s’inscrire dans un lien de dépendance institutionnel très fort. Il n’existe pas de critère unique déterminant. Selon le Conseil d’Etat, le seul contrôle de tutelle ne suffit pas (CE, 27 juillet 2001, CAMIF, n°218067.)
Cette dépendance doit être caractérisée par plusieurs éléments repris à l’article A 123-1. L’acheteur public doit avoir une influence déterminante sur toutes ses décisions essentielles et ses objectifs stratégiques, en désignant, par exemple, plus de la moitié des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise ou en nommant son dirigeant. Cela signifie, en fait, que l’entité ne doit disposer d’aucune autonomie dans son fonctionnement et dans son activité et ne doit pas pouvoir déterminer, notamment, les prestations qu’elle doit exécuter, leur contenu, et leur tarif (CJUE, 19 avril 2007, Asociacion Profesional de Empresas Forestales). Le contrôle fonctionnel et structurel (CJUE, 17 juillet 2008, Commission c/ Italie, C-371/05) doit être effectif et non simplement formel (CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte, n°365079).
1.2 Le cocontractant de l’acheteur public doit réaliser plus de 80% de son activité pour ce dernier.
Le seul constat d’une dépendance à l’égard de l’acheteur public ne suffit pas à qualifier les prestations faisant l’objet du contrat de quasi-régie. En effet, ce n’est que lorsque le rapport organique qui unit l’acheteur public à son cocontractant se double d’une quasi-exclusivité de la fourniture des prestations au profit du premier, que le cocontractant est considéré comme totalement lié à celui-ci et que les prestations peuvent être comparées à celles dont disposeraient l’acheteur en recourant à ses propres ressources internes.
Le respect de la seconde condition posée par l’article LP 123-1 I ainsi que par la jurisprudence implique donc que le cocontractant de l’acheteur soit un opérateur « dédié » aux besoins de ce dernier. Il doit réaliser l’essentiel de son activité avec ou pour le compte de la personne ou des personnes qui le contrôlent.
La condition est considérée comme satisfaite dès lors que l’entité concernée exerce plus de 80% de son activité dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par le ou les acheteurs publics qui la contrôlent. Par conséquent, cette entité peut exercer jusqu’à 20% de ses activités sur le marché concurrentiel.
Si l’entité consacre une partie de son activité à des tiers, ces activités annexes doivent ainsi revêtir un caractère marginal (CJUE, 11 mai 2006, Carbotermo SpA).
L’article A 123-2 précise que le pourcentage d’activités réalisé par l’entité dédiée doit être déterminé en prenant en compte le chiffre d’affaires total moyen au cours des trois exercices comptables précédant l’attribution du marché public. Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale contrôlée ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois derniers exercices comptables ou n’est plus pertinent, le calcul du pourcentage d’activités est déterminé sur la base d’une estimation vraisemblable pouvant notamment résulter de projections d’activités.
1.3 Une participation privée au capital exclut, en principe, toute relation de quasi-régie.
Les contrats conclus par les acheteurs publics avec des sociétés dont le capital est détenu au moins pour partie par des actionnaires privés sont, en principe, exclus de la qualification de contrats de quasi-régie et entrent dans le champ d’application du code polynésien des marchés publics.
Néanmoins, l’article LP 123-1 3 °) introduit un assouplissement important s’agissant de l’interdiction de participations directes de capitaux privés au sein de l’entité contrôlée.
La participation de capitaux privés peut ainsi être admise dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
– Les capitaux privés ne doivent conférer aucune capacité de contrôle ou de blocage des décisions de l’entité ;
– Ces formes de participations de capitaux privés doivent être requises par une loi ou un règlement ;
– L’actionnaire privé ne peut exercer une influence décisive sur l’entité contrôlée.
Le seul fait que la société contrôlée soit constituée, par exemple, sous la forme d’une société d’économie mixte (SEM) ne suffit cependant pas à considérer que la loi requiert que son capital soit mixte.
Si la législation applicable aux SEM prévoit bien la participation de capitaux privés, il s’agit uniquement d’une condition de fond permettant d’adopter la forme de société souhaitée. Rien n’impose cependant le choix de ce type de structure. La présence de participations privées au capital n’apparaît ainsi pas requise par la loi elle-même mais imposée par le choix d’une forme de société particulière. La situation des SEM ne peut ainsi être assimilée à celle d’organismes publics à adhésion obligatoire avec participation d’opérateurs économiques privés spécifiques requise par la loi elle-même, cas que vise l’exception dont il s’agit.
Par ailleurs, quand bien même le législateur imposerait la création d’une société prenant la forme d’une SEM, le critère selon lequel les formes de participations de capitaux privés doivent être imposées par la loi ne suffit pas à lui seul pour caractériser une relation de quasi-régie. Ainsi, il doit également être démontré que la présence de capitaux privés ne confère aucune capacité de contrôle ou de blocage et ne permet d’exercer aucune influence décisive.
2. Les critères de qualification du contrat de quasi-régie horizontal, dit entre « sœurs »
Introduit par la loi du Pays n° 2018-21 du 4 mai 2018, le contrat de quasi-régie « horizontal » visé à l’article LP 123-1 II concerne l’achat de prestations entre deux personnes morales qui sont placées sous le contrôle d’un même acheteur public.
Ces contrats passés entre entités dites « sœurs » sont également exclus du champ d’application du code polynésien des marchés publics dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
– Les deux personnes morales sont soumises au contrôle analogue d’un même acheteur public (sur la notion de contrôle analogue voir point 1.1 supra) ;
– La personne morale à laquelle est attribuée le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi ou les règlements qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée (sur cette deuxième condition voir les commentaires au point 1.3 ci-dessus)
En pratique, cela signifie par exemple qu’un établissement public de la Polynésie française peut contracter directement, sans publicité et mise en concurrence, avec un autre établissement public du Pays.
3. L’octroi d’un droit exclusif (art. LP123-1, III)
Cette exclusion, déjà présente dans l’ancien code des marchés publics du Pays (ancien article 3ter), ne concerne que les marchés de services tels que définis à l’article LP 122-2 III du CPMP.
Le droit exclusif peut être défini comme la situation dans laquelle est confié à une personne, par un acte législatif ou réglementaire, l’exercice d’une mission d’intérêt général. Ce droit a pour effet de réserver à cette personne l’exercice de l’activité en cause. En conséquence, l’acheteur public peut s’adresser à cette personne directement, c’est-à-dire sans formalité de publicité ou de mise en concurrence, pour lui demander une prestation de services.
C’est ainsi le cas par exemple pour le service postal en Polynésie française.
L’Office des Postes et Télécommunications (OPT) bénéficie d’un droit exclusif en vertu de l’article D112-6 du code des postes et télécommunications : « Est exclusivement réservé à l’exploitant public, le cumul des opérations de relevage, de tri, d’acheminement et de distribution pour les objets postaux suivants :
– 1° objets de correspondance jusqu’au poids de 2 kilogrammes ;
– 2° papiers et objets de publipostage adressés jusqu’au poids de 2 kilogrammes.
Il est en conséquence interdit à toute personne physique ou morale de s’immiscer dans les activités définies ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 112-9 à D. 112-11 du présent code. »
De même, en vertu de l’article D212-9 dudit code, l’OPT bénéficie d’un droit exclusif pour établir et exploiter les réseaux de télécommunication permettant d’offrir au public des services de télécommunication fixe.
Section 2 – Exclusions à raison de l’objet des marchés
Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux marchés publics suivants :
1° Marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d’application du présent code ;
2° Marchés de services financiers liés à l’émission, à l’achat, à la vente ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers définis à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;
3° Marchés de services qui sont des contrats d’emprunt, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers mentionnés au 2° ;
4° Marchés de services de recherche et développement pour lesquels l’acheteur public n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
5° Marchés qui ont pour objet la création ou l’acquisition d’œuvres et d’objets d’art au sens de l’article LP 111-20 du code du patrimoine de la Polynésie française, d’objets d’artisanat traditionnel au sens de la délibération n° 2009-55 APF du 11 août 2009 portant mise en place d’une procédure d’agrément au profit des artisans traditionnels de Polynésie française ou l’achat d’objets d’antiquité et de collection ;
6° Marchés de services relatifs à la conciliation ;
7° Marchés passés dans le domaine des télécommunications ouvert à la concurrence et qui ont principalement pour objet de permettre l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunication ouverts au public et la fourniture au public de services de télécommunication ;
8° Marchés de services qui ont pour objet les prestations de soins dispensées par les professionnels de santé médicaux et paramédicaux ;
9° Marchés de services passés dans les domaines artistiques au sens de l’article LP 1 de la loi du pays n° 2021-18 du 6 avril 2021 portant reconnaissance des professions artistiques de Polynésie française et diverses mesures de soutien à ces professions ;
10° Marchés de services juridiques ayant pour objet :
– la certification et l’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
– la représentation légale par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle lorsque celle-ci est rendue obligatoire par un texte législatif ou réglementaire ;
– la consultation juridique d’un avocat en vue de la préparation de toute procédure juridictionnelle ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ;
11° Marchés de services qui ont pour objet l’achat d’espaces publicitaires sur quel que support que ce soit.
Certains contrats sont exclus du champ d’application du code polynésien des marchés publics en raison de l’objet du marché.
Ces exclusions, figurant à l’article LP 123-2 du code, sont notamment les suivantes :
– les contrats d’acquisition ou de location de biens immobiliers, notamment de bâtiments existants, ou de droits réels sur ces biens. La justification de cette exclusion tient au fait que les marchés relatifs à l’acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens concernent souvent un périmètre géographique précis et reposent sur des critères subjectifs, rendant difficile l’application de mesures de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, les contrats passés avec des mandataires, tels que des agences immobilières, sont, en revanche, des contrats de services soumis au code des marchés publics. Le Tribunal des Conflits a jugé qu’un mandat exclusif de vente d’un bâtiment conclu entre une commune et une agence immobilière doit être qualifié de marché public de service dès lors qu’il a été conclu à titre onéreux en vue de la fourniture d’une prestation de service (TC, 14 mai 2012, SARL la Musthyere) ;
– les contrats de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers définis à l’article L.211-1 du code monétaire et financier ; Cette exclusion des règles du CPMP se justifie par la spécificité des marchés financiers, « où il est jugé nécessaire de prendre rapidement des décisions qui ne peuvent être entravées par une excessive formalisation des procédures.» (Rapport de la Cour des comptes de 2009 sur les risques pris par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux en matière d’emprunts). Les marchés de services financiers exigent, en effet, tout à la fois un degré de confidentialité et une réactivité incompatibles avec les délais de mise en concurrence inhérents à tout marché public ;
– les marchés de services de recherche et développement pour lesquels l’acheteur public n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation. Seul constitue donc un marché public soumis au code, le contrat dans lequel l’acheteur public est amené à acquérir l’intégralité de la propriété des résultats du programme de recherche et à assurer l’intégralité de son financement ;
La loi du Pays n° 2019-37 du 20 décembre 2019 a étendu le champ des exclusions du CPMP à certains achats eu égard à leurs spécificités. En effet, dans les secteurs de l’art, des arts traditionnels et des activités artistiques, le législateur polynésien a constaté que les opérateurs économiques polynésiens étaient insuffisamment structurés et professionnalisés pour être en mesure de répondre à des procédures de marchés publics. En conséquence, sont exclus du CPMP, les marchés de création ou d’acquisition d’œuvres et d’objets d’arts, d’objets d’artisanat ou l’achat d’objets d’antiquité et de collection (Article LP 123-2 5°) ainsi que les achats de prestations dans le domaine des activités artistiques (Article LP 123-2 9°).
Dans le secteur de la santé et afin d’assurer la permanence des soins dans les îles éloignées, le CPMP (Article LP 123-2 8°) exclu également l’application des règles du droit des marchés publics aux achats de prestations de soins dispensés par les professionnels de santé médicaux ou paramédicaux.
Section 3 – Autres exclusions
Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas :
1° aux marchés publics bénéficiant d’un financement alloué sur les ressources du Fonds européen de développement lorsque la réglementation financière applicable audit Fonds prévoit l’application de règles de passation et d’exécution particulières applicables à ces mêmes marchés ;
2° aux marchés publics conclus entre acheteurs publics et dont l’objet consiste à établir ou mettre en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun, à condition que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt général ;
3° aux concours techniques apportés par la Polynésie française aux communes ou à leurs groupements en application de l’article 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
4° aux conventions en matière de réalisation d’équipements collectifs ou projets d’équipements collectifs et en matière de gestion de services publics conclues en application de l’article 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
5° aux concours apportés par l’État et par les organismes ou établissements publics métropolitains mentionnés à l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
6° aux marchés publics, conclus selon une procédure prévue par un accord international y compris un arrangement administratif, portant sur des travaux, fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage par la Polynésie française et les parties signataires de cet accord international ou arrangement ou par l’un de leurs établissements publics ou opérateurs désignés.
Extrait du guide des bonnes pratiques pour la passation des marchés publics – Edition janvier 2020- SGG
1. Les contrats de coopération « public-public » prévus à l’article LP 123-3-2°
Aux termes de l’article LP 123-3 2° du CPMP, les contrats de coopération entre acheteurs publics visant à atteindre des objectifs communs en lien avec leurs missions de service publics respectives peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence dès lors qu’ils respectent les conditions posées par cet article.
1°) La coopération public-public doit avoir pour objet d’assurer conjointement la réalisation de missions de services publics en vue d’atteindre des objectifs communs.
Les acheteurs doivent établir ou mettre en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun.
La mission d’intérêt général doit être commune aux personnes publiques contractantes, de sorte que se trouvent exclus tous les cas où une mission serait simplement confiée unilatéralement par une personne publique à une autre et où la première se bornerait à jouer un rôle d’auxiliaire pendant que la seconde prendrait en charge l’ensemble de la mission
Cela ne signifie pas nécessairement que chaque personne publique doive participer à l’exécution de la mission d’une manière identique. La coopération peut, en effet, reposer sur une division des tâches ou sur un certain degré de spécialisation. Néanmoins, le contrat doit impliquer une exécution conjointe de la même mission, une véritable coopération, par opposition à un marché public ordinaire, où l’une des parties exécute une prestation définie contre rémunération. Une attribution unilatérale d’une tâche par un acheteur à un autre ne saurait être regardée comme une coopération. L’un des acheteurs ne doit ainsi pas pouvoir être considéré comme un donneur d’ordres et l’autre comme un prestataire.
2°) la « coopération public-public » ne doit obéir qu’à des considérations d’intérêt général
La mise en œuvre des dispositions relatives à la « coopération public-public » est conditionnée à la poursuite exclusive de considérations d’intérêt public.
Les conditions de mise en œuvre de la coopération, notamment les transferts financiers entre les personnes publiques, ne doivent pas pouvoir être regardés comme le résultat d’une activité commerciale. Ainsi, alors même que les acheteurs répondent, par le biais de leur coopération, à des objectifs communs de service public, la condition d’intérêt public exclusif ne peut être satisfaite que pour autant qu’aucune relation commerciale n’en découle. La coopération doit révéler une collaboration authentique, même si elle implique « des droits et obligations réciproques ».
Les coûts et frais de gestion résultant de la coopération doivent présenter un caractère raisonnable par rapport aux pratiques du marché. Un coût qui serait égal ou supérieur aux coûts d’une entité privée pourrait ainsi laisser penser que l’acheteur public agit comme un prestataire réalisant une activité commerciale pour les besoins d’une personne publique, et non comme une entité publique dans le cadre de sa mission d’intérêt public. Plus généralement, la coopération ne peut impliquer des transferts entre les partenaires publics autres que ceux correspondant au remboursement des frais réellement encourus pour les travaux, services, ou fournitures.
A titre d’exemple, une convention de partenariat conclue entre plusieurs communes pour la mise en place et la mutualisation des services d’incendies et de secours par laquelle chacune contribue par la mise à disposition de moyens humains, matériels et financiers afin d’assurer la couverture opérationnelle des services d’incendies et de secours de leur territoire relève de cette exception.
Le juge administratif a pu considérer qu’une convention d’entente conclue entre collectivités territoriales au sens des dispositions de l’article L. 5221-1 du CGCT n’est pas soumise aux règles de la commande publique dès lors que cette entente ne permet pas une intervention à des fins lucratives de l’une de ces personnes publiques au profit de l’autre (CE 3 février 2012, Commune Veyrier-du-Lac req. 353737).
2. Les autres cas de coopération entre acheteurs publics
Il s’agit pour l’essentiel des hypothèses de coopération envisagées par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française et notamment :
a) des concours techniques apportés par la Polynésie française aux communes ou à leurs groupements en application de l’article 54 : « En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.
Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l’article 140 et dénommé “loi du pays”.
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le Président de la Polynésie française et les communes. »
b) des conventions en matière de réalisation d’équipements collectifs ou projets d’équipements collectifs et en matière de gestion de services publics conclues en application de l’article 55 « Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d’une demande ou d’un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française. Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.
Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d’une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays ». »
c) des concours apportés par l’État et par les organismes ou établissements publics métropolitains mentionnés à l’article 169 : « A la demande de la Polynésie française et par conventions, l’Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.
Des conventions entre l’Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l’Etat.
Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation. »
.