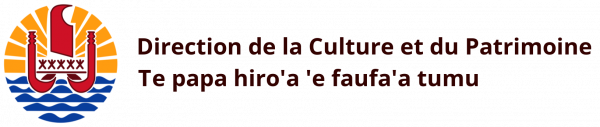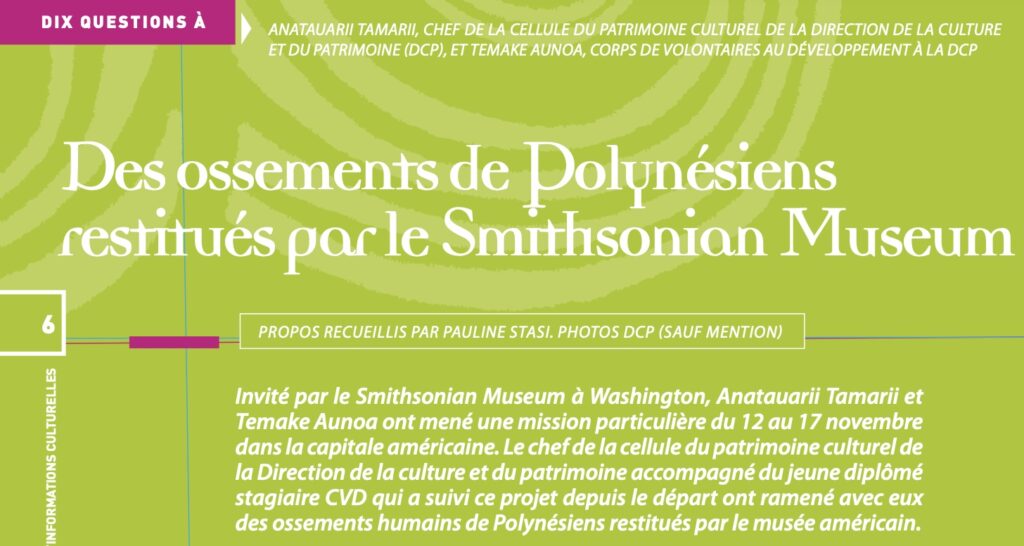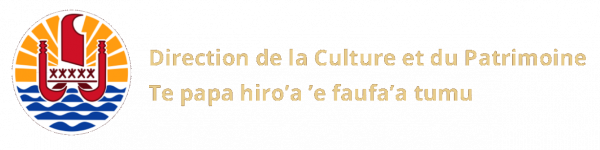Des ossements de Polynésiens restitués par le Smithsonian Museum (Hiro’a n° 204 – Décembre 2024)
Invités par le Smithsonian Museum à Washington, Anatauarii Tamarii et Temake Aunoa ont menés une mission particulière du 12 au 17 novembre dans la capitale américaine. Le chef de la cellule du patrimoine culturel de la Direction de la culture et du patrimoine accompagné de la jeune diplômée stagiaire CVD qui a suivi ce projet depuis le départ ont ramenés avec eux des ossements humains de Polynésiens restitués par le musée américain.
Quelle est la genèse de cette mission ?
Temake Aunoa : « Le 7 février 2024, nous avons reçu un mail adressé à la DCP de monsieur Keitapu Maamaatuaiahutapu avec une pièce jointe. C’était un mémorandum daté du 16 mai 1958, cité dans un article publié en 2023 dans The Washington Post, révélant que le Smithsonian Museum détenait plus de 30 700 restes humains, dont certains provenaient de la Polynésie française. Suite à ce mail, j’ai alors fait un travail de recherches et je me suis aperçue qu’il y avait en réalité deux autres mémorandums d’ossements polynésiens. »
Que contenaient ces trois mémorandums ?
Temake Aunoa : « Le mémorandum adressé par Keitapu Maamaatuaiahutapu faisait directement référence à des prélèvements réalisés par la Smithsonian-Bredin Expedition de 1957, sous la direction du Dr. Waldo L. Schmitt. Le second mémorandum, daté d’avril 1956, faisait état des restes humains collectés dans sept régions océaniennes et appartenant aux Collections of the Winstar Institute. Enfin, le troisième mémorandum mentionnait des restes humains donnés par Medford Kellum en 1958. »
Que savez-vous de ces restes humains ?
Temake Aunoa : « Ils ont été collectés entre 1956 et 1958 à Tahiti et à Makatea. La datation carbone n’a pas été réalisée, par contre il existe un rapport ostéologique détaillé de ces restes humains. Il y a notamment un crâne complet d’un jeune homme, un autre d’un enfant de 9-11 ans, des fragments de crâne d’un nourrisson… Au total, ces restes humains pourraient représentés entre 7 à 15 individus. »
Comment avez-vous pris contact avec le Smithsonian Museum ?
Anatauarii Tamarii : « J’ai parlé de ces mémorandums à Éliane Tevahitua, qui était à l’époque vice-présidente et ministre de la Culture. Elle a adressé un courrier officiel au Smithsonian Museum le 7 mars 2024 pour demander la restitution des restes humains (ivi tupuna). Le 19 mars, on a reçu une réponse positive du musée. On a alors entamé des discussions préparatoires par visioconférences avec l’équipe du musée afin de mettre en place une coordination rigoureuse pour cette restitution. Le Smithsonian Museum nous a alors invités à Washington pour les rapatrier. »
Comment s’est déroulée la restitution ?
Anatauarii Tamarii : « Nous sommes restés trois jours sur place. Nous avons commencé par une visite guidée privée de certaines expositions. Cette visite à travers les galeries a été l’occasion pour le musée de présenter le programme de travail mis en place pour la restitution des ivi tupuna, ainsi que les modalités prévues pour cette opération. Ensuite, nous nous sommes rendus dans le bâtiment des réserves du musée sous la conduite de Rhonda Coolidge, une réunion formelle s’est tenue pour aborder les aspects pratiques et symboliques de l’opération. Nous avons expliqué les objectifs de cette restitution et souligné l’importance de ces initiatives pour les communautés locales des îles. Les discussions ont également portées sur les modalités concrètes de la restitution, notamment l’organisation d’une cérémonie en présence des membres de l’équipe du musée ayant travaillé sur ce projet. »
Qu’avez-vous ressenti lors de la restitution de ces ossements ?
Temake Aunoa : « Beaucoup d’émotions. L’équipe du musée nous a fait rentrer dans la salle de conservation où étaient entreposés les ivi tupuna, nous avons pu confirmer l’état de conservation des restes humains et vérifier leur correspondance avec les rapports de provenance fournis par le NMNH (National Museum of Natural History, NDLR). »
Comment avez-vous préparé le voyage de retour à Tahiti ?
Anatauarii Tamarii : « Nous les avons conditionnés en coordination étroite avec l’équipe du Smithsonian Museum, et notamment de Rhonda Coolidge, dont l’expertise avérée en matière de restitution des restes humains a été déterminante pour garantir que toutes les procédures soient exécutées selon les standards internationaux requis. Nous avons supervisés l’emballage et le conditionnement des restes humains, en veillant à leurs conservations et à leurs dignités. Les ossements ont été emballés dans deux sacs, une malle de type Pelican et un carton, ce dernier étant conditionné dans un sac de transport adapté pour assurer une protection optimale pendant le transfert. À noter qu’une attention particulière a été portée à la documentation associée. Nous avons bénéficié d’une escorte organisée par le service du protocole de l’aéroport. Grâce aux démarches préalables entreprises par le Smithsonian Museum, les services douaniers avaient été informés de la sensibilité de ce transfert, et il avait été demandé que les colis ne fassent pas l’objet de fouilles, ni de passage par rayons X. Cette demande a été scrupuleusement respectée, garantissant ainsi le respect des normes éthiques et culturelles liées au transport des ivi tupuna. »
Que deviennent les ossements ramenés ?
Anatauarii Tamarii : « Pour l’instant, nous les avons ramenés à la DCP. Notre souhait est qu’ils retournent sur leurs terres d’origine en organisant avec les communes une cérémonie de restitution. »
Cette restitution pourrait-elle donner lieu à d’autres collaborations avec le Smithsonian Museum ?
Anatauarii Tamarii : « Nous avons discuté d’un partenariat entre nos deux établissements qui pourrait se faire sous la forme d’une convention formelle, favorisant des échanges réguliers et structurés dans les domaines de la recherche, de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel. Cette convention pourrait inclure des programmes de formation pour les agents de la DCP, des opportunités de recherches collaborative, ainsi que des projets de restitution et d’étude sur d’autres collections patrimoniales d’intérêt pour la Polynésie française. Par ailleurs lors de notre séjour, nous avons visité les réserves du Smithsonian Museum, notamment les collections relatives aux objets issus des îles de la Polynésie française (…). Parmi les pièces les plus remarquables figuraient des objets sacrés et des éléments de grande valeur historique et culturelle. Ces découvertes ont ouvert la voie à une réflexion sur l’éventualité d’une future restitution de certains de ces objets sacrés, en conformité avec les dispositions prévues par le NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act). Dans cette perspective, il a été convenu qu’il serait nécessaire d’intégrer le Musée de Tahiti et des îles aux discussions pour définir les priorités et modalités d’une telle restitution. »
D’autres discussions ou projets sontils en cours ou envisagés avec d’autres musées américains ?
Anatauarii Tamarii : « Oui. Cette mission ne constitue pas une fin en soi. La DCP poursuit actuellement des discussions avec le musée d’Arizona en vue de négocier la restitution des restes humains polynésiens. Ces démarches témoignent d’une volonté constante de la Polynésie française de renforcer les liens avec son patrimoine culturel dispersé à travers le monde. » ◆
Document à télécharger
Des ossements de Polynésiens restitués par le Smithsonian Museum (Hiro’a n° 204 – Décembre 2024)