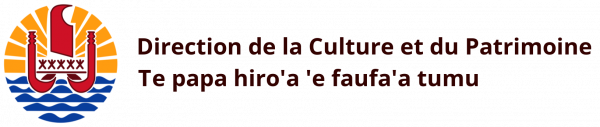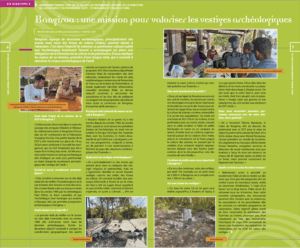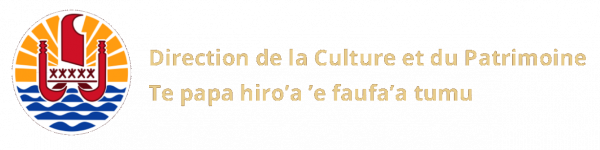Rangiroa : une mission pour valoriser les vestiges archéologiques – (Hiro’a n°213 – Septembre 2025)
Propos recueillis par Lucie Ceccarelli – Photos : DCP
Rangiroa regorge de structures archéologiques, principalement des marae mais aussi des fosses de culture (māite), souvent laissés à l’abandon. C’est dans l’objectif de valoriser ce patrimoine culturel oublié que l’archéologue Anatauarii Tamarii a accompagné sur place une délégation de la Direction de la culture et du patrimoine (DCP). Il nous explique les enjeux de sa mission, première d’une longue série, qui a consisté à réévaluer le corpus archéologique de l’atoll.
Quel était l’objet de la mission de la DCP à Rangiroa ?
« Cette mission s’inscrivait dans le cadre du passage des pirogues Hōkūle’a et Hikianalia, initialement prévu à Rangiroa à l’occasion du 50e anniversaire de la Polynesian Voyaging Society. Une petite équipe de la DCP a été missionnée sur place du 14 au 20 juin pour participer à l’accueil des navigateurs, qui ne s’est finalement pas fait à cause d’un timing trop serré. J’ai été associé à cette mission en tant qu’archéologue afin d’intégrer un volet plus patrimonial, en étant chargé du récolement archéologique des vestiges de l’atoll. »
Qu’est-ce qu’un récolement archéologique ?
« Cela consiste à retourner sur un site déjà visité afin de vérifier s’il existe toujours et, le cas échéant, d’en dresser un état des lieux. Ma mission faisait suite aux travaux menés dans les années 1960 par les ethnologues Paul Ottino et Anne Lavondès, et par l’archéologue José Garanger, qui avaient, à l’époque, fait une première prospection archéologique à Rangiroa. »
Quels étaient vos objectifs ?
« Le premier était de vérifier sur le terrain les sites déjà inventoriés dans les années 1960 afin d’alimenter notre base de données archéologiques, Rumia.
Le deuxième objectif consistait à corriger les coordonnées géographiques des points erronés ou inexacts de l’ancien système de projection GPS.
Mon troisième objectif était d’évaluer l’état de conservation des sites retrouvés, notamment les marae les plus emblématiques comme ceux de Pomariorio et Tivaru ou de la dune de Teonemahue. Je devais également identifier d’éventuelles nouvelles structures.
Enfin, un dernier objectif consistait à rencontrer les associations et les élus afin de préfigurer un programme de prospection pluriannuel dans toute la commune de Rangiroa, incluant les atolls alentours. »
Pourquoi cette volonté de mener ce travail à Rangiroa ?
« Aucune mission de ce genre n’y a été menée depuis les années 1960. En janvier 2024, quand se sont tenues les premières Assises de l’archéologie, on avait mis en lumière le fait que l’archipel des Tuamotu était, avec les Australes, le moins documenté et qu’il fallait par conséquent y initier des programmes. L’objectif, à terme, est de parvenir à une reconnaissance à l’échelle du pays des structures archéologiques des Tuamotu. »
Quels sont ces vestiges archéologiques ?
« On a principalement vu des marae, qui entrent donc dans la catégorie des vestiges religieux et cérémoniels, mais on a également identifié et recolé d’autres vestiges comme des māite, des fosses de culture. On aimerait installer des panneaux informatifs à l’école et sur le motu de Taeo΄o (dit du Lagon bleu) rappelant ce que sont les māite, comment ils étaient organisés, ce qu’on y cultivait…, afin de montrer la vaste culture vivrière qui existait autrefois aux Tuamotu. »
Que sont exactement les māite ?
« Dans cet archipel où l’environnement est sec, salé et corallien, les anciens pa΄umotu ont développé une agriculture ingénieuse et durable en creusant des fosses pour atteindre la nappe d’eau douce et permettre la culture de plantes vivrières essentielles à la survie des populations.
Un māite est une fosse de 30 à 150 m² de surface, d’une profondeur plus ou moins variée, creusée dans le sable corallien à l’aide de pelles fabriquées en nacre ou en carapace de tortue.
Il existe tout un schéma organisationnel autour de la création d’un māite, depuis le creusement de la fosse jusqu’à la culture des plantes, en passant par la création d’un compost végétal soigneusement élaboré avec des feuilles particulières, dont la décomposition crée des couches de terre fertile. »
Combien de māite avez-vous répertorié à Rangiroa ?
« Il y en a des centaines, voire des milliers, par atoll ! Par exemple, sur un petit motu de 5 000 m² à Rangiroa, on a compté environ 1 500 m² de māite. »
Où sont situés les vestiges ?
« Sur tous les motu. Là où les gens sont établis aujourd’hui, à Avatoru et Tiputa, il n’y a pas grand-chose. Il faut aller dans les districts et les motu avoisinants. La population était davantage à Otepipi avant. On sait aussi que le motu Taeo΄o, avec tous ses māite, était bien peuplé, puis la population a bougé, suite aux guerres et aux cataclysmes qui ont eu lieu aux alentours du XVIe siècle. »
Vous avez rencontré plusieurs personnes ressources lors de cette mission, dans quel but ?
« On a rencontré Tahuhu Maraeura, le maire de Rangiroa, afin de discuter du partenariat avec la DCP pour la mise en valeur du patrimoine culturel de l’atoll.
On a fait la même chose avec Michel Toromona, l’actuel président du comité du tourisme.
On a également eu l’occasion d’interviewer Punua Tamaehu, navigateur reconnu et détenteur de savoir traditionnel, ainsi que Ruahatu a Tetua.
Ils nous ont transmis un corpus de 45 légendes qu’on va éditer en un livret, notre premier concernant les légendes des Tuamotu. »
Quelle va être la suite de cette mission ?
« Maintenant qu’on a procédé au récolement, l’idée est de se rendre sur des motu qui n’ont pas été prospectés afin de mettre à jour de nouveaux marae, māite ou structures d’habitation. Il s’agit d’un travail sur le long terme, l’idée serait d’y retourner tous les trimestres.
Avec cette nouvelle cartographie, des discussions pourront être menées avec la commune, les associations et les propriétaires afin de conduire un véritable programme de valorisation.
Notre objectif ultime serait de faire reconnaître le patrimoine des Tuamotu au travers, pourquoi pas, d’un classement au titre des monuments historiques du pays. Cela permettrait de lancer plus facilement des opérations de restauration ou de mise en valeur des vestiges. »
Anatauarii TAMARII, chef de la cellule du patrimoine culturel de la Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa Hiro’a ΄e Faufā’a Tumu
Document à télécharger :
Rangiroa : une mission pour valoriser les vestiges archéologiques- (Hiro’a n° 213 – Septembre 2025)