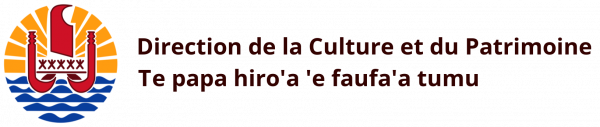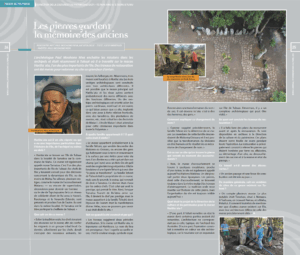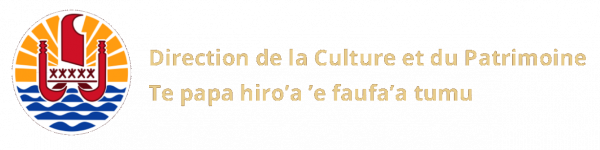Les pierres gardent la mémoire des anciens (Hiro’a n° 215 – Novembre 2025)
L’archéologue Paul Moohono Niva enchaîne les missions dans les archipels et était récemment à Tubuai où il a travaillé sur le marae Hariita’ata, l’un des plus importants de l’île. Des travaux de restauration ont été menés pour redonner au site sa splendeur d’antan.
Questions et réponses avec Paul Moohono Niva
Hariita’ata est-il un site réputé ou qui a eu une importance particulière ?
Hariita’ata se trouve sur l’île de Tubuai dans la localité de Tamatoa sur la commune de Mahu. Ce marae est également appelé marae Tamatoa. C’est l’un des plus importants de l’île de Tubuai : les chefs de l’île y tenaient conseil pour des décisions concernant la dynamique de l’île, ou du moins de Mahu. Par ailleurs, plusieurs vestiges, comme le marae de l’accouchement Matarau ou encore de supercission, circoncision pour devenir un homme ou le site de Taputapuātea lié à un réseau de solidarité allant de Ra’iātea à Hawai’i, Rarotonga et la Nouvelle-Zélande, sont présents et proches l’un de l’autre. Ils sont dans la même localité. Et Tamatoa est le titre porté par la chefferie de Tubuai.
Que sait-on de ce marae ?
Selon la tradition orale, les chefs tenaient des réunions sur le marae, afin de confier les migrants à un groupe tribal local. Ce dernier, sélectionné par les chefs, devait s’occuper des nouveaux arrivants, les nourrir, les héberger, etc. Néanmoins, trois marae sont localisés à Hariita’ata. Les trois vestiges archéologiques sont construits avec trois architectures différentes. Il est possible que le marae principal soit Hariita’ata et les deux autres portent probablement des noms différents avec des fonctions différentes. Un des vestiges archéologiques est orienté selon les points cardinaux, nord-sud et est-ouest, ce qui laisse penser que ce site, implanté dans une zone à forte relation horticole, avec des tarodières, des plantations de manioc, etc., était utilisé lors des festivités de Matari’i. L’étoile Matari’i était attendue pour cette cérémonie importante dans toute la Polynésie.
À quelle famille appartenait-il ? À quel culte était-il dédié ?
Le marae appartient probablement à la famille Tehoiri, qui semble descendre des Mokorea ou Orovaru, ou encore des gens qui habitaient sous la terre et remontaient à la surface par une rivière pour voler du taro. L’un d’entre eux a été capturé dans un champ (pa’i taro) avec un filet. On dit qu’il avait des ongles très longs et pointus. Il fut le fondateur d’une lignée Tehoiri qui veut dire « la peau se transforme ». La famille Tehoiri de Tubuai était la propriétaire de ce marae, mais sans le pouvoir, le mana, qui revenait de droit à Tamatoa. Ce dernier était choisi par les autres chefs. C’est celui qui avait le prestige, qui prenait le titre. Ainsi, lorsque Tamatoa Faaneti de Ra’iātea arrive sur l’île, il devient le chef par prestige, mais le marae appartient à la famille Tehoiri, dont l’épouse de Faaneti était la manifestation divine. Hélas, nous ne pouvons pas savoir à qui était dédié le site.
Sait-on quand il a été construit et par qui ?
Les travaux suggèrent deux périodes d’utilisation. Si le marae est Hariita’ata, le toponyme est Hariiteura. Le nom du lieu est prestigieux : hari’i signifie accueillir et ura, c’est la couleur rouge, symbole royal. Il existe alors une transformation du nom : de ura, il est devenu ta’ata, c’est-à-dire des hommes, des gens.
Comment expliquer ce changement de nom ?
Comme suggéré précédemment, la famille Tehoiri est la détentrice de ce marae. Les membres de cette famille descendraient de Mokorea/Orovaru et il est possible que la transformation du Mokorea en être humain est le résultat de ce mécanisme de changement de nom.
Est-ce sur ce site qu’on trouve la pierre qui servait au moment des accouchements ?
Non, le marae d’accouchement se trouve à quelques encablures, proche d’une rivière, le site est également appelé aujourd’hui Raitoro/Matarau. Un site pouvait porter deux éponymes. Les pierres, dont celle d’accouchement, se trouvent toujours dans la rivière malgré les travaux d’aménagement. La tradition orale reste muette sur l’histoire de cette pierre, mais l’organisation du site est toujours visible aujourd’hui.
Quel était le projet de la Direction de la culture et du patrimoine pour le marae Hariita’ata ?
D’une part, il fallait remettre en état le marae dont certaines parties avaient été remaniées. L’architecture ne correspondait pas à celle, typique, de l’archipel des Australes. D’autre part, l’opération consistait à remettre en valeur un site archéologique, car le tourisme est en expansion sur l’île de Tubuai. Désormais, il y a un complexe archéologique qui peut être visité.
En quoi ont consisté les travaux de restauration ?
Il a fallu faire des plans du monument avant et après la restauration. Ils sont disponibles en archives à la Direction de la culture et du patrimoine. Ces plans étaient notre feuille de route pendant toute l’opération. La restauration a principalement consisté à relever les pierres qui étaient tombées par terre ou affaissées, au démontage d’un ahu, au dessouchement des racines et à la remise en état du pavage.
Ce travail a-t-il amené des découvertes ?
Un ancien pavage et une fosse de combustion ont été mis au jour.
De manière générale, sait-on combien de sites de ce genre existent sur Tubuai ?
On compte plusieurs marae. Le plus notable était Tonohae, situé à Mataura. À Taahuaia, on trouvait Peetau, et à Mahu, Potuitui. Il convient toutefois de mentionner que d’autres marae existent sur l’île, mais leur architecture diffère de celle des marae précédemment cités.