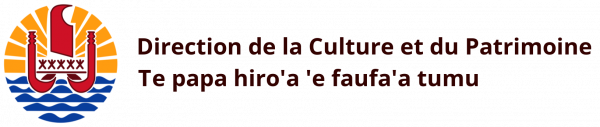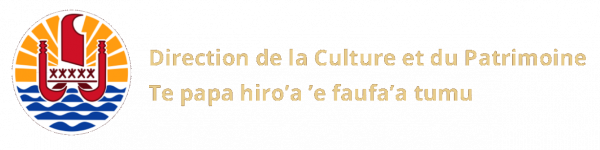Cinquantenaire de Hōkūle’a : les pirogues traditionnelles accueillies à Taputapuātea puis Pā’ofa’i – (Hiro’a n° 212 – Août 2025)
Cinquantenaire de Hōkūle’a : les pirogues traditionnelles accueillies à Taputapuātea puis Pā’ofa’i – (Hiro’a n° 212 – Août 2025)
Fin juin, les pirogues doubles Hōkūle’a et Hikianalia ont abordé les îles polynésiennes, d’abord à Taputapuātea, à Ra’iātea le 24 juin, puis dans les jardins de Pā’ofa’i, à Pape’ete le 28. Ces deux embarcations, construites selon des techniques ancestrales, ont parcouru des milliers de kilomètres depuis Hawaii afin de promouvoir la navigation traditionnelle et de renforcer le lien entre les peuples insulaires du Pacifique, près de cinquante ans après leur première traversée inaugurale. Deux grandes cérémonies étaient organisées par la Direction de la culture et du patrimoine pour les accueillir. Jarvis Teauroa, directeur adjoint, nous raconte ces festivités, entre rites traditionnels et liesse populaire.
Depuis, Hōkūle’a sillonne le Pacifique, et même le monde. Dans quel but ?
« Sa mission est de faire la promotion de la navigation traditionnelle. Avec l’actuel capitaine, Nainoa Thompson, est venu se rajouter un message écologique, en faveur de la protection des océans. »
Hōkūle’a vient d’effectuer une nouvelle traversée depuis Hawaii. Quel a été son trajet ?
« Ce trajet se nomme traditionnellement Te Ara i Tahiti, Ke ala i Kahiki en hawaiien. Il s’agit de la route traditionnelle, tracée par les ancêtres, reliant Hawaii à Tahiti. »
Quel est le message véhiculé en em- pruntant cette route cette année ?
« Le voyage actuel de Hōkūle’a a plusieurs objectifs. Le premier, c’est de célébrer les cinquante ans de la Polynesian Voyaging Society. Le deuxième est de poursuivre le voyage Moananuiākea, entamé en 2022 mais interrompu en 2024. La première destination choisie pour cette reprise a été la Polynésie française, avec une par- ticularité cette année : pour la première fois, Hōkūle’a a abordé Ra’iātea avant Tahiti. Cette décision est très symbo- lique puisque Ra’iātea, plus précisément Taputapuātea, est considéré comme le berceau du monde polynésien. »
Cette année, on célèbre les cinquante ans de Hōkūle’a. Pouvez-vous m’en dire plus sur son premier voyage effectué entre Hawaii et Tahiti en 1976 ?
« Son arrivée à Tahiti en 1976 a été un événement populaire qui a rassemblé environ 17 000 personnes sur la plage Sigogne à Pape’ete, par la suite renommée plage Hōkūle’a. D’un point de vue patrimonial et scientifique, c’est depuis cette traversée-là que l’on a compris que les Polynésiens pouvaient naviguer sans instrument. Avant cela, la théorie la plus répandue était que les Océaniens voyageaient et découvraient les îles un peu au gré du hasard. Le voyage de Hōkūle’a est venu prouver qu’ils naviguaient de manière traditionnelle en sachant où ils allaient. »
Qu’est-ce qui était prévu à Taputapuātea pour son arrivée le 24 juin ?
« L’accueil a été grandiose. La Direction de la culture et du patrimoine, avec l’appui des anciens, de la communauté de Ra’iātea, des associations culturelles et de la commune de Taputapuātea, est intervenue pour organiser la cérémonie dans un aspect très spirituel. Il y a un protocole très scellé à suivre. Hōkūle’a, accompagnée de Hikianalia et Fa’afaite, devait entrer par la passe sacrée Te Ava Mo’a après en avoir reçu l’autorisation symbolique. Ensuite, il y a eu le rite du Tai Rapa Ti’a, le lever des rames, avant l’accueil sur la plage Taura’a Tapu. Ensuite, l’équipage est venu se recueillir sur les différents marae qui composent le site, avant de participer à la cérémonie du ‘ava, qui vient symboliser l’alliance entre les pirogues et la communauté de Ra’iātea. »
La population de l’île était-elle présente ?
« Oui, il y avait au total entre 1 500 et 2 500 personnes, en comptant les délégations hawaiienne, taïwanaise et pascuane. Il y avait notamment les élèves et professeurs des Kamehameha Schools de Hawaii, qui accompagnent la Polynesian Voyaging Society dans tous ses déplacements afin de se charger, en quelque sorte, des protocoles culturels hawaiiens. »
Le lendemain, Hōkūle’a a quitté Ra’iātea pour rejoindre Tahiti. Comment s’est passée cette seconde arrivée, le 28 juin dans les jardins de Pā’ofa’i ?
« J’en tire un bilan très positif, notamment parce que le timing a été respecté, ce qui est assez rare. Ce qui prend beaucoup de temps dans les cérémonies d’accueil des va’a, c’est le transbordement de l’équipage. Les pirogues étant amarrées à des corps-morts, il faut faire traverser quatre à cinq personnes à la fois, sur des plateformes installées sur des pirogues. »
Quel accueil était-il prévu à Pape’ete ?
« J’aimerais tout d’abord remercier tous nos partenaires qui ont participé à la cérémonie. Notamment l’association Tainui – Friends of Hokule’a, le Conservatoire artistique de Polynésie française, l’association Fa’afaite i te ao mā’ohi, le groupe pupu ‘ori Hei Tahiti et bien d’autres. L’accueil était différent de Ra’iātea, où la cérémonie était très spirituelle, alors qu’à Tahiti, l’événement était davantage populaire, avec 2 000 à 3 000 personnes présentes. On avait quand même prévu un accueil traditionnel au son des pahu, avec une cérémonie de recueillement et de ‘ava sur le paepae de Hōkūle’a suivie par la levée d’un nouveau unu, sculpté spécialement à cet effet. »
Quelle a été la suite du programme ?
« Quand la cérémonie culturelle a pris fin, on a basculé sur un événement plus populaire, entamé par les discours des officiels puis poursuivi par des prestations communes de la section des arts traditionnels du Conservatoire artistique de Polynésie française et des Kamehameha Schools. Ces prestations ont constitué selon moi un moment fort de la cérémonie, car elles sont venues concrétiser un partenariat entre les deux écoles signé quelques jours plus tôt. La soirée s’est achevée par un concert. Le ministère de la Culture a par ailleurs voulu mettre l’accent sur la jeunesse et la transmission. On s’est rendu compte en effet que beaucoup d’enfants ne connaissaient pas l’histoire passionnante de Hōkūle’a. Nous avons donc diffusé à la télévision des petites capsules vidéo avec des images d’archives de 1976 à nos jours, pour expliquer les origines de ce va’a. »
Quelle est la suite du parcours de Hōkūle’a ?
« À Tahiti, il est prévu qu’elle se rende à Mataiea puis à Tautira, où son capitaine a des liens très anciens avec la communauté. Elle doit ensuite aller à Moorea. Bora Bora sera la dernière escale en Polynésie française. Elle l’atteindra le 6 août. Après quoi, elle va continuer vers les îles Cook puis la Nouvelle-Zélande en septembre. Hōkūle’a poursuivra son voyage Moananuiākea dans le Pacifique (prévu pour durer 47 mois, NDLR). »