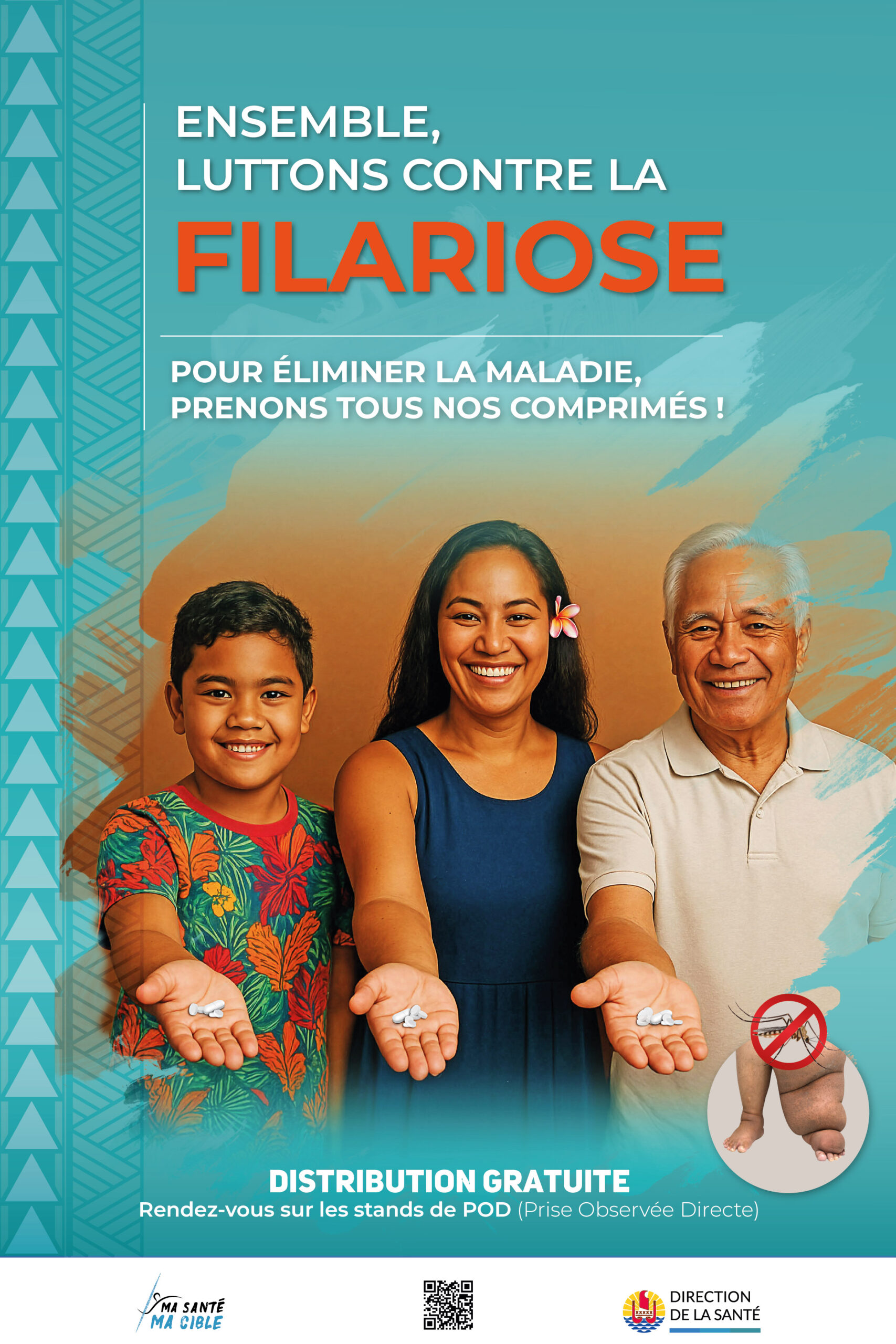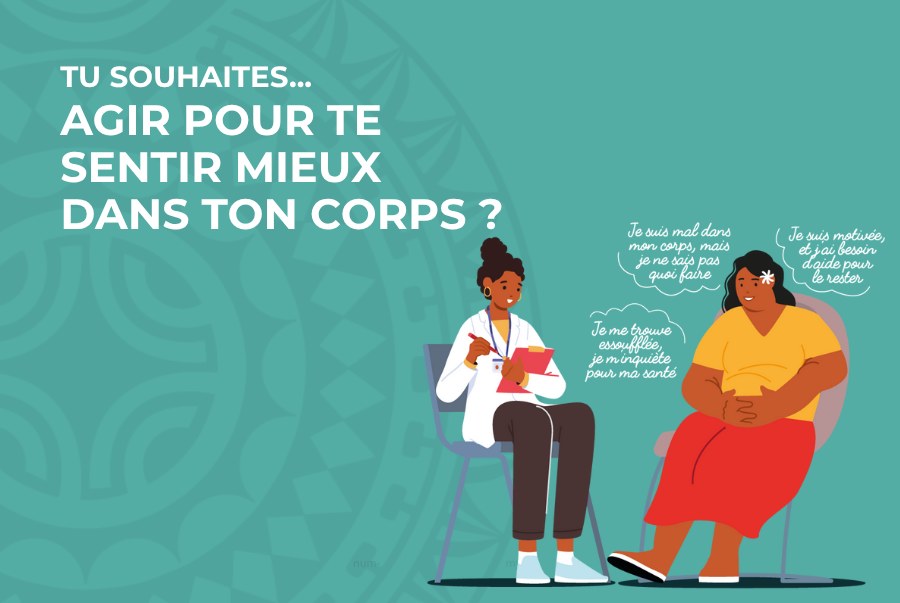Annuaire des structures de la Direction de la santé
[ACTUALITÉS]
Voeux de la Direction de la santé
‘ia ora na i te matahiti api ! Bonne année 2025 !
La Direction de la santé vous souhaite une excellente année 2025, pleine de réussite, d’épanouissement et de santé !
En 2025, nous avons à cœur de faire des individus et de leurs familles de véritables acteurs de leur santé, de recréer le leadership des soins de santé de proximité, de repenser le rôle et l’organisation de nos hôpitaux périphériques, de renforcer l’attractivité de nos services pour attirer et fidéliser les talents, et enfin, d’améliorer l’efficacité de notre système de santé dans son ensemble.
Mauruuru roa à tous les agents de la Direction de la santé pour leur engagement à construire ensemble la santé de demain !
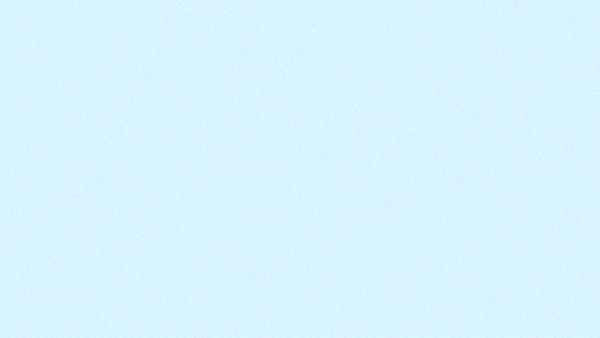
Voeux de la Direction de la santé
‘ia ora na i te matahiti api ! Bonne année 2025 !
La Direction de la santé vous souhaite une excellente année 2025, pleine de réussite, d’épanouissement et de santé !
En 2025, nous avons à cœur de faire des individus et de leurs familles de véritables acteurs de leur santé, de recréer le leadership des soins de santé de proximité, de repenser le rôle et l’organisation de nos hôpitaux périphériques, de renforcer l’attractivité de nos services pour attirer et fidéliser les talents, et enfin, d’améliorer l’efficacité de notre système de santé dans son ensemble.
Mauruuru roa à tous les agents de la Direction de la santé pour leur engagement à construire ensemble la santé de demain !
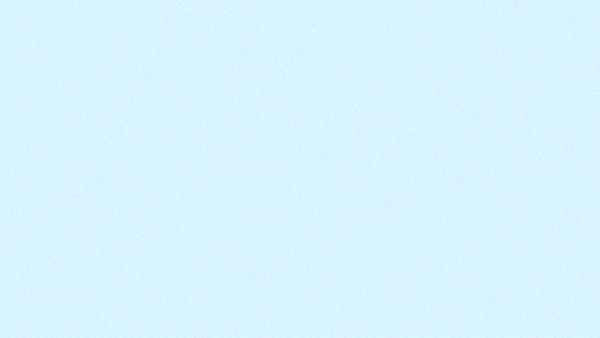
[ACTUALITÉS]
Dry January, janvier sans alcool au Fenua
Lancement de la 3e édition du Dry January
Après une deuxième édition réussie qui avait réuni plus de 250 personnes âgées de 25 à 40 ans, dont une majorité de femmes, le Dry January 2025 revient. Pour rappel le Dry January est un défi lancé sur le mois de janvier à toute la population. Le challenge est simple : il s’agit de faire une pause dans sa consommation d’alcool durant 30 jours afin de bien commencer l’année.
Le Dry January c’est :
– Une campagne qui s’adresse aux personnes qui souhaitent réfléchir à leur consommation d’alcool et faire l’expérience d’une pause ;
– L’occasion de découvrir de nouveaux plaisirs comme dîner chez soi, se relaxer, voir ses proches… sans y associer l’alcool afin de repérer les verres qui ne correspondent pas à un choix délibéré mais à une routine.Le Dry January ce n’est pas :
– Une campagne qui vise les personnes dépendantes à l’alcool ;
– Un mouvement qui pousse à se priver de quelque chose. Au contraire, le défi invite à essayer quelque chose de nouveau et à en explorer ses bénéfices ;
– La volonté de faire de l’alcool un tabou. Ce défi encourage plutôt à définir la place que prend l’alcool dans nos vies.8 bonnes raisons d’y participer :
– Faire le point sur sa consommation d’alcool ;
– Être en forme ;
– Avoir meilleure mine ;
– Réduire sa consommation de mauvais sucre ;
– Mieux dormir ;
– Être plus serein ;
– Réguler sa consommation d’alcool sur le long terme ;
– Faire des économies.Cette année nous proposons un accompagnement inédit, avec une communauté Facebook dédiée. Les participants auront l’opportunité de se motiver mutuellement et participer à des challenges pour tenter de remporter des cadeaux.
Informations pratiques :
– Date de lancement : 1er janvier 2025
– Date de fin : 31 janvier 2025
– Comment participer : Inscription gratuite via notre groupe Facebook « Dry January Polynésie française »Nous rappelons à la population que ce challenge ne rentre pas dans le traitement des addictions. Pour les personnes souffrant de dépendance et présentant des symptômes de manque, il est nécessaire d’être accompagné. Tout arrêt brutal et non suivi par des professionnels peut être dangereux. Le Centre de Prévention et de Soin des Addictions (CPSA) se tient à disposition au 40 46 00 67 pour plus de renseignements.
Dry January, janvier sans alcool au Fenua
Lancement de la 3e édition du Dry January
Après une deuxième édition réussie qui avait réuni plus de 250 personnes âgées de 25 à 40 ans, dont une majorité de femmes, le Dry January 2025 revient. Pour rappel le Dry January est un défi lancé sur le mois de janvier à toute la population. Le challenge est simple : il s’agit de faire une pause dans sa consommation d’alcool durant 30 jours afin de bien commencer l’année.
Le Dry January c’est :
– Une campagne qui s’adresse aux personnes qui souhaitent réfléchir à leur consommation d’alcool et faire l’expérience d’une pause ;
– L’occasion de découvrir de nouveaux plaisirs comme dîner chez soi, se relaxer, voir ses proches… sans y associer l’alcool afin de repérer les verres qui ne correspondent pas à un choix délibéré mais à une routine.Le Dry January ce n’est pas :
– Une campagne qui vise les personnes dépendantes à l’alcool ;
– Un mouvement qui pousse à se priver de quelque chose. Au contraire, le défi invite à essayer quelque chose de nouveau et à en explorer ses bénéfices ;
– La volonté de faire de l’alcool un tabou. Ce défi encourage plutôt à définir la place que prend l’alcool dans nos vies.8 bonnes raisons d’y participer :
– Faire le point sur sa consommation d’alcool ;
– Être en forme ;
– Avoir meilleure mine ;
– Réduire sa consommation de mauvais sucre ;
– Mieux dormir ;
– Être plus serein ;
– Réguler sa consommation d’alcool sur le long terme ;
– Faire des économies.Cette année nous proposons un accompagnement inédit, avec une communauté Facebook dédiée. Les participants auront l’opportunité de se motiver mutuellement et participer à des challenges pour tenter de remporter des cadeaux.
Informations pratiques :
– Date de lancement : 1er janvier 2025
– Date de fin : 31 janvier 2025
– Comment participer : Inscription gratuite via notre groupe Facebook « Dry January Polynésie française »Nous rappelons à la population que ce challenge ne rentre pas dans le traitement des addictions. Pour les personnes souffrant de dépendance et présentant des symptômes de manque, il est nécessaire d’être accompagné. Tout arrêt brutal et non suivi par des professionnels peut être dangereux. Le Centre de Prévention et de Soin des Addictions (CPSA) se tient à disposition au 40 46 00 67 pour plus de renseignements.
[ACTUALITÉS]
Droit de réponse de la Direction de la santé – Uturoa
Lors de son déplacement du 5 décembre 2024 à l’hôpital de Uturoa, la Direction de la santé a pu prendre la pleine mesure de la souffrance causée à ses agents par la publication du « Relevé d’échanges et d’observations » récemment paru dans les médias.
Après s’être excusée des maladresses de communication interne ayant généré une telle situation, elle tient à rassurer la population quant à la qualité des soins fournis aux patients des Raromatai par un personnel dévoué au sein de cet établissement de référence.
Par ce communiqué, la Directrice de la Santé réaffirme son soutien à l’hôpital de Uturoa et à ses équipes et insiste sur l’importance de poursuivre le travail collectif pour garantir des conditions optimales de soins et renforcer la confiance du public dans l’hôpital et ses professionnels.
Pour plus d’informations : Cellule communication
Téléphone : 40 46 61 79 – 40 46 61 83
Email : communication.dsp@administration.gov.pfDroit de réponse de la Direction de la santé – Uturoa
Lors de son déplacement du 5 décembre 2024 à l’hôpital de Uturoa, la Direction de la santé a pu prendre la pleine mesure de la souffrance causée à ses agents par la publication du « Relevé d’échanges et d’observations » récemment paru dans les médias.
Après s’être excusée des maladresses de communication interne ayant généré une telle situation, elle tient à rassurer la population quant à la qualité des soins fournis aux patients des Raromatai par un personnel dévoué au sein de cet établissement de référence.
Par ce communiqué, la Directrice de la Santé réaffirme son soutien à l’hôpital de Uturoa et à ses équipes et insiste sur l’importance de poursuivre le travail collectif pour garantir des conditions optimales de soins et renforcer la confiance du public dans l’hôpital et ses professionnels.
Pour plus d’informations : Cellule communication
Téléphone : 40 46 61 79 – 40 46 61 83
Email : communication.dsp@administration.gov.pf[ACTUALITÉS]
Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et la Covid-19 pour la saison 2024-2025
La Direction de la santé lance aujourd’hui sa nouvelle campagne de vaccination conjointe contre la grippe saisonnière et la Covid-19. Celle-ci s’étendra jusqu’au 30 avril 2025 inclus. Comme chaque année, cette campagne vise à protéger les populations les plus vulnérables face aux risques graves que représentent la grippe et la Covid-19, en particulier pour les personnes âgées de plus de 60 ans, les patients avec des pathologies chroniques, les femmes enceintes, et les personnes exerçant dans des professions exposées, tels que les professionnels de santé et les personnels navigants (aérien et maritime).
Malgré une baisse de la menace mondiale liée à la Covid-19, le virus continue de circuler, notamment avec le variant JN.1, présentant des risques pour les populations sensibles. En effet, le bilan de la campagne saisonnière 2023-2024 fait état de 259 hospitalisations liées à la grippe, avec 11 décès en Polynésie, tandis que la Covid-19 a causé 75 hospitalisations et 3 décès.
Cette initiative de vaccination conjointe offre donc la possibilité d’une administration simultanée des deux vaccins. Elle est sans délai spécifique entre les deux, afin de simplifier et renforcer la protection des personnes à risque. Ces vaccinations sont gratuites pour les publics cibles dans toutes les structures de soins de la Direction de la santé ainsi que dans les pharmacies conventionnées de Tahiti et des îles sous le vent. Les vaccins sont également en vente libre pour toute personne souhaitant se protéger.
Pour rappel, la grippe saisonnière est une infection respiratoire aigüe qui se caractérise, après une période d’incubation d’environ deux jours, par l’apparition brutale d’une fièvre supérieure à 38°C, de malaise général, de maux de tête, de maux de gorge, d’écoulement nasal, de toux (généralement sèche), de douleurs musculaires et articulaires. Ces symptômes peuvent parfois évoluer vers des complications graves, notamment des pneumonies sévères, susceptibles d’entraîner des hospitalisations, des passages en réanimation et, dans les cas les plus critiques, des décès, en particulier chez les personnes vulnérables.
La Direction de la santé rappelle également l’importance des mesures barrières, comme le port du masque et l’hygiène des mains, pour limiter la propagation des virus.
Ensemble, faisons le choix de la prévention. Faites-vous vacciner pour passer des moments en famille en toute sécurité !
Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et la Covid-19 pour la saison 2024-2025
La Direction de la santé lance aujourd’hui sa nouvelle campagne de vaccination conjointe contre la grippe saisonnière et la Covid-19. Celle-ci s’étendra jusqu’au 30 avril 2025 inclus. Comme chaque année, cette campagne vise à protéger les populations les plus vulnérables face aux risques graves que représentent la grippe et la Covid-19, en particulier pour les personnes âgées de plus de 60 ans, les patients avec des pathologies chroniques, les femmes enceintes, et les personnes exerçant dans des professions exposées, tels que les professionnels de santé et les personnels navigants (aérien et maritime).
Malgré une baisse de la menace mondiale liée à la Covid-19, le virus continue de circuler, notamment avec le variant JN.1, présentant des risques pour les populations sensibles. En effet, le bilan de la campagne saisonnière 2023-2024 fait état de 259 hospitalisations liées à la grippe, avec 11 décès en Polynésie, tandis que la Covid-19 a causé 75 hospitalisations et 3 décès.
Cette initiative de vaccination conjointe offre donc la possibilité d’une administration simultanée des deux vaccins. Elle est sans délai spécifique entre les deux, afin de simplifier et renforcer la protection des personnes à risque. Ces vaccinations sont gratuites pour les publics cibles dans toutes les structures de soins de la Direction de la santé ainsi que dans les pharmacies conventionnées de Tahiti et des îles sous le vent. Les vaccins sont également en vente libre pour toute personne souhaitant se protéger.
Pour rappel, la grippe saisonnière est une infection respiratoire aigüe qui se caractérise, après une période d’incubation d’environ deux jours, par l’apparition brutale d’une fièvre supérieure à 38°C, de malaise général, de maux de tête, de maux de gorge, d’écoulement nasal, de toux (généralement sèche), de douleurs musculaires et articulaires. Ces symptômes peuvent parfois évoluer vers des complications graves, notamment des pneumonies sévères, susceptibles d’entraîner des hospitalisations, des passages en réanimation et, dans les cas les plus critiques, des décès, en particulier chez les personnes vulnérables.
La Direction de la santé rappelle également l’importance des mesures barrières, comme le port du masque et l’hygiène des mains, pour limiter la propagation des virus.
Ensemble, faisons le choix de la prévention. Faites-vous vacciner pour passer des moments en famille en toute sécurité !
[COMMUNIQUÉ]
RAIATEA – Avis d’enquête Commodo et Incommodo N°24-35/ENV/IC et de consultation du public
Dans le cadre de la demande d’autorisation d’installer et exploiter une cuve d’oxygène liquide, un banaliseur, une laverie et un groupe électrogène à l’hôpital de Uturoa (commune de Uturoa), une enquête Commodo et Incommodo est ouverte du 5 novembre au 5 décembre 2024.Le public peut venir consulter le dossier aux heures d’ouverture de la mairie de Uturoa et formuler ses remarques dans un registre ouvert à cet effet. Un plan de localisation sera également présent.Monsieur Freddy GOLASOWSKY, commissaire enquêteur, se tient à la disposition du public dans la mairie de Uturoa :– le jeudi 7 novembre 2024 de 8h à 11h– le lundi 18 novembre 2024 de 8h à 11h– le mardi 19 novembre 2024 de 8h à 11h– le jeudi 21 novembre 2024 de 8h à 11h
[COMMUNIQUÉ] RAIATEA – Avis d’enquête Commodo et Incommodo N°24-35/ENV/IC et de consultation du public
Dans le cadre de la demande d’autorisation d’installer et exploiter une cuve d’oxygène liquide, un banaliseur, une laverie et un groupe électrogène à l’hôpital de Uturoa (commune de Uturoa), une enquête Commodo et Incommodo est ouverte du 5 novembre au 5 décembre 2024.Le public peut venir consulter le dossier aux heures d’ouverture de la mairie de Uturoa et formuler ses remarques dans un registre ouvert à cet effet. Un plan de localisation sera également présent.Monsieur Freddy GOLASOWSKY, commissaire enquêteur, se tient à la disposition du public dans la mairie de Uturoa :– le jeudi 7 novembre 2024 de 8h à 11h– le lundi 18 novembre 2024 de 8h à 11h– le mardi 19 novembre 2024 de 8h à 11h– le jeudi 21 novembre 2024 de 8h à 11h[ACTUALITÉS]
Risques liés aux produits de lissage pour cheveux contenant de l’acide glyoxylique
Quatre cas d’insuffisance rénale aiguë ont été recensés en France métropolitaine après l’application de produits dits « lissages brésiliens » contenant de l’acide glyoxylique.
L’acide glyoxylique est une substance chimique utilisée dans certains produits de cosmétique pour ses qualités d’agent lissant. Certains des produits disponibles chez les professionnels de la coiffure ou en vente libre en Polynésie française peuvent en contenir. Il est donc recommandé aux professionnels et aux consommateurs d’être vigilants et de vérifier attentivement la composition avant l’utilisation.
L’usage de cette substance n’est pas restreint à ce jour dans les produits cosmétiques. Néanmoins, une expertise est engagée au niveau de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Dans l’attente et par mesure de précaution, la vigilance concernant l’utilisation des produits lissants contenant de l’acide glyoxylique, reste de mise, et, compte-tenu du risque associé, il est déconseillé d’utiliser ces produits.
Quels sont les signes d’une insuffisance rénale et quelle est la conduite à tenir ?
Les signes d’insuffisance rénale apparaissent quelques heures après l’exposition à l’acide glyoxylique inclus dans le produit. Ils se manifestent par des douleurs abdominales ou lombaires, des nausées et/ou des vomissements.
En cas d’apparition de tels symptômes, il faut consulter rapidement un médecin, en indiquant bien l’utilisation d’un produit de lissage. La prise en charge médicale rapide avec un traitement adapté a permis de guérir les personnes intoxiquées.
Au-delà d’une prise en charge rapide, la déclaration par le professionnel de santé contribuera à documenter le besoin d’encadrer l’usage de la substance dans ce type d’application.
Pour plus d’informations :
Centre de santé environnementale de la Direction de la santé
156 Avenue Georges Clémenceau, 98714 Papeete – Tahiti
Téléphone : 40 50 37 45
Email : cse@sante.gov.pfRisques liés aux produits de lissage pour cheveux contenant de l’acide glyoxylique
Quatre cas d’insuffisance rénale aiguë ont été recensés en France métropolitaine après l’application de produits dits « lissages brésiliens » contenant de l’acide glyoxylique.
L’acide glyoxylique est une substance chimique utilisée dans certains produits de cosmétique pour ses qualités d’agent lissant. Certains des produits disponibles chez les professionnels de la coiffure ou en vente libre en Polynésie française peuvent en contenir. Il est donc recommandé aux professionnels et aux consommateurs d’être vigilants et de vérifier attentivement la composition avant l’utilisation.
L’usage de cette substance n’est pas restreint à ce jour dans les produits cosmétiques. Néanmoins, une expertise est engagée au niveau de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Dans l’attente et par mesure de précaution, la vigilance concernant l’utilisation des produits lissants contenant de l’acide glyoxylique, reste de mise, et, compte-tenu du risque associé, il est déconseillé d’utiliser ces produits.
Quels sont les signes d’une insuffisance rénale et quelle est la conduite à tenir ?
Les signes d’insuffisance rénale apparaissent quelques heures après l’exposition à l’acide glyoxylique inclus dans le produit. Ils se manifestent par des douleurs abdominales ou lombaires, des nausées et/ou des vomissements.
En cas d’apparition de tels symptômes, il faut consulter rapidement un médecin, en indiquant bien l’utilisation d’un produit de lissage. La prise en charge médicale rapide avec un traitement adapté a permis de guérir les personnes intoxiquées.
Au-delà d’une prise en charge rapide, la déclaration par le professionnel de santé contribuera à documenter le besoin d’encadrer l’usage de la substance dans ce type d’application.
Pour plus d’informations :
Centre de santé environnementale de la Direction de la santé
156 Avenue Georges Clémenceau, 98714 Papeete – Tahiti
Téléphone : 40 50 37 45
Email : cse@sante.gov.pf[ACTUALITÉS]
Qualité des eaux destinées à la consommation à Tahiti et dans les îles en 2023
Le Centre de santé environnementale (CSE) de la Direction de la santé a poursuivi en 2023, sa mission de contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par les réseaux et fontaines publics.
En parallèle, 20 communes et le syndicat intercommunal Te Oropaa ont initié un programme de contrôle de la qualité de l’eau sur tout ou partie de leurs ressources, fontaines publiques et/ou réseaux de distribution et 7 communes des Tuamotu (Anaa, Arutua, Hao, Manihi, Rangiroa, Reao et Takaroa) ont initié leurs autocontrôles sur tout ou partie de leurs ressources et/ou fontaines à carte prépayée. Il est à relever les efforts mis en place par les communes éloignées pour lesquelles la logistique (du fait des faibles fréquences aériennes) est complexe et le coût de transport (du fait de l’éloignement) est plus important.
Au total, 1584 prélèvements ont été effectués sur des réseaux de distribution, 29 prélèvements sur des fontaines de distribution à carte prépayée (Tuamotu), 313 prélèvements sur des fontaines publiques et 97 prélèvements sur des ressources.
Les résultats de la qualité des eaux distribuées sont établis à partir de l’ensemble des résultats obtenus. Ils sont synthétisés dans les documents ci-joints et notamment sur les cartes ci-jointes.
Il apparaît que 63% de la population a accès à l’eau potable en Polynésie française en 2023. Au sein de chaque archipel, la part de population ayant accès à l’eau potable est :
– 69% aux Iles du Vent ;
– 77% aux Iles Sous-le-Vent ;
– 23% aux Australes ;
– 1% aux Tuamotu-Gambier ;
– 0% aux Marquises.
Les principaux résultats sont les suivants :
- En 2023, 12 communes ont distribué de l’eau potable sur l’ensemble de leur territoire : Arue, Faa’a, Mahina, Papeete, Pirae, Punaauia, Papara, Bora Bora, Huahine, Tumaraa, Taputapuatea et Uturoa.
- 3 communes ont délivré de l’eau potable sur une partie de leur territoire : Taiarapu Est (réseaux Lucas, Hélène Auffray et Van Bastolaer), Moorea (réseaux Nuuroa, Papetoai, Temae, Maharepa 1 et 2 et Haumi) et Rurutu (réseaux Hauti et Moerai).
- A Tahiti, l’excellente qualité de l’eau desservie dans la zone urbaine (sauf à Paea) et Papara se maintient. Concernant les communes de la zone rurale (hormis les réseaux Lucas, Hélène Auffray et Van Bastolaer de Taiarapu Est), l’eau distribuée est toujours non potable.
- A Moorea, seuls 6 réseaux sur 22 sont potables. Néanmoins, leur extension régulière permet d’augmenter la part de la population ayant accès à l’eau potable d’année en année.
- Aux îles Sous-le-Vent, la régularité de Bora Bora, Tumaraa et Uturoa dont l’eau est potable depuis 2017. Pour Taputapuatea la qualité de l’eau reste variable mais présente d’excellents résultats pour 2023, comme pour Huahine. La qualité de l’eau reste variable avec encore des non-conformités sur Tahaa.
- Aux Australes, la qualité de l’eau reste variable, avec des efforts maintenus notamment sur Rurutu.
- Quant aux archipels des Marquises et des Tuamotu-Gambier, encore beaucoup de mauvais résultats, voire l’absence d’analyses, qui imposent réglementairement de déclarer leurs eaux non potables.
Les raisons de la mauvaise qualité de l’eau distribuée sont connues : l’utilisation exclusive de captages d’eaux superficielles, la mauvaise exploitation des installations de traitement d’eau potable, la vétusté des ouvrages existants, l’absence de traitement adapté et de désinfection des ressources, le non fonctionnement d’installations de traitement d’eau alors qu’elles ont été réceptionnées.
Sur les 272 résultats non conformes relevés sur les réseaux, 261 (soit 96%) montraient la présence de germes témoins de contamination fécale. A noter que 128 analyses présentaient des Escherichia coli, bactéries pathogènes pour l’homme. 58 analyses (21%) présentaient des non-conformités physico-chimiques, et notamment une forte turbidité, signe du recours à des eaux de surface connues pour être vulnérables aux apports terrigènes.
En 2023, sur les 23 fontaines publiques contrôlées (hors Tuamotu), seules les fontaines Papemato à Papara, Van Bastolaer et Hélène Auffray à Taiarapu Est et Temae, Paopao, Nuuroa, Afareaitu et Vaiare à Moorea ont délivré une eau potable. Pour certaines fontaines publiques pourtant équipées de systèmes de traitement de l’eau, les résultats s’avèrent variables et généralement non potables. C’est également le constat qui est fait aux Tuamotu sur les 23 fontaines à cartes prépayées contrôlées, bien que le peu de résultats ne permette pas de généraliser la situation.
Les efforts et les investissements doivent se poursuivre. En outre, le recours à des outils d’aide peut également s’avérer utile, tels que la mise en œuvre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE), outil préconisé par l’OMS depuis 2004. Il convient de relever que 4 PSSE ont été établis par les communes de Bora Bora, Papeete, Pirae et Moorea et que dans le cadre du programme PROTEGE (Projet régional océanien des Territoires pour la gestion durable des écosystèmes), 6 PSSE supplémentaires ont été finalisés (Rimatara, Paea, Tumaraa, Mahina, Hao et Tubuai). Grâce au projet PROTEGE, des outils d’aide et de communication ont également pu être réalisés et un atelier interrégional s’est tenu en avril 2024 pour présenter notamment les PSSE aux maires de Polynésie française.
Le rapport 2023 et les cartes de qualité des eaux de consommation sont disponibles sous les liens suivants :
- Descriptif des ressources en eau et des travaux réalisés et programmés sur les réseaux de distribution par les communes de Polynésie française au 31 décembre 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée à Tahiti et Moorea en 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée aux îles Sous-le-Vent en 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée aux Australes et Marquises en 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée aux Tuamotu-Gambier en 2023
- Qualité des eaux distribuées par les réseaux publics de distribution en 2023
- Qualité des eaux distribuées par les fontaines publiques en 2023
- Qualité des ressources en eau exploitées en 2023
- Evolution de la qualité de l’eau par réseau public de distribution
Qualité des eaux destinées à la consommation à Tahiti et dans les îles en 2023
Le Centre de santé environnementale (CSE) de la Direction de la santé a poursuivi en 2023, sa mission de contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par les réseaux et fontaines publics.
En parallèle, 20 communes et le syndicat intercommunal Te Oropaa ont initié un programme de contrôle de la qualité de l’eau sur tout ou partie de leurs ressources, fontaines publiques et/ou réseaux de distribution et 7 communes des Tuamotu (Anaa, Arutua, Hao, Manihi, Rangiroa, Reao et Takaroa) ont initié leurs autocontrôles sur tout ou partie de leurs ressources et/ou fontaines à carte prépayée. Il est à relever les efforts mis en place par les communes éloignées pour lesquelles la logistique (du fait des faibles fréquences aériennes) est complexe et le coût de transport (du fait de l’éloignement) est plus important.
Au total, 1584 prélèvements ont été effectués sur des réseaux de distribution, 29 prélèvements sur des fontaines de distribution à carte prépayée (Tuamotu), 313 prélèvements sur des fontaines publiques et 97 prélèvements sur des ressources.
Les résultats de la qualité des eaux distribuées sont établis à partir de l’ensemble des résultats obtenus. Ils sont synthétisés dans les documents ci-joints et notamment sur les cartes ci-jointes.
Il apparaît que 63% de la population a accès à l’eau potable en Polynésie française en 2023. Au sein de chaque archipel, la part de population ayant accès à l’eau potable est :
– 69% aux Iles du Vent ;
– 77% aux Iles Sous-le-Vent ;
– 23% aux Australes ;
– 1% aux Tuamotu-Gambier ;
– 0% aux Marquises.
Les principaux résultats sont les suivants :
- En 2023, 12 communes ont distribué de l’eau potable sur l’ensemble de leur territoire : Arue, Faa’a, Mahina, Papeete, Pirae, Punaauia, Papara, Bora Bora, Huahine, Tumaraa, Taputapuatea et Uturoa.
- 3 communes ont délivré de l’eau potable sur une partie de leur territoire : Taiarapu Est (réseaux Lucas, Hélène Auffray et Van Bastolaer), Moorea (réseaux Nuuroa, Papetoai, Temae, Maharepa 1 et 2 et Haumi) et Rurutu (réseaux Hauti et Moerai).
- A Tahiti, l’excellente qualité de l’eau desservie dans la zone urbaine (sauf à Paea) et Papara se maintient. Concernant les communes de la zone rurale (hormis les réseaux Lucas, Hélène Auffray et Van Bastolaer de Taiarapu Est), l’eau distribuée est toujours non potable.
- A Moorea, seuls 6 réseaux sur 22 sont potables. Néanmoins, leur extension régulière permet d’augmenter la part de la population ayant accès à l’eau potable d’année en année.
- Aux îles Sous-le-Vent, la régularité de Bora Bora, Tumaraa et Uturoa dont l’eau est potable depuis 2017. Pour Taputapuatea la qualité de l’eau reste variable mais présente d’excellents résultats pour 2023, comme pour Huahine. La qualité de l’eau reste variable avec encore des non-conformités sur Tahaa.
- Aux Australes, la qualité de l’eau reste variable, avec des efforts maintenus notamment sur Rurutu.
- Quant aux archipels des Marquises et des Tuamotu-Gambier, encore beaucoup de mauvais résultats, voire l’absence d’analyses, qui imposent réglementairement de déclarer leurs eaux non potables.
Les raisons de la mauvaise qualité de l’eau distribuée sont connues : l’utilisation exclusive de captages d’eaux superficielles, la mauvaise exploitation des installations de traitement d’eau potable, la vétusté des ouvrages existants, l’absence de traitement adapté et de désinfection des ressources, le non fonctionnement d’installations de traitement d’eau alors qu’elles ont été réceptionnées.
Sur les 272 résultats non conformes relevés sur les réseaux, 261 (soit 96%) montraient la présence de germes témoins de contamination fécale. A noter que 128 analyses présentaient des Escherichia coli, bactéries pathogènes pour l’homme. 58 analyses (21%) présentaient des non-conformités physico-chimiques, et notamment une forte turbidité, signe du recours à des eaux de surface connues pour être vulnérables aux apports terrigènes.
En 2023, sur les 23 fontaines publiques contrôlées (hors Tuamotu), seules les fontaines Papemato à Papara, Van Bastolaer et Hélène Auffray à Taiarapu Est et Temae, Paopao, Nuuroa, Afareaitu et Vaiare à Moorea ont délivré une eau potable. Pour certaines fontaines publiques pourtant équipées de systèmes de traitement de l’eau, les résultats s’avèrent variables et généralement non potables. C’est également le constat qui est fait aux Tuamotu sur les 23 fontaines à cartes prépayées contrôlées, bien que le peu de résultats ne permette pas de généraliser la situation.
Les efforts et les investissements doivent se poursuivre. En outre, le recours à des outils d’aide peut également s’avérer utile, tels que la mise en œuvre des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE), outil préconisé par l’OMS depuis 2004. Il convient de relever que 4 PSSE ont été établis par les communes de Bora Bora, Papeete, Pirae et Moorea et que dans le cadre du programme PROTEGE (Projet régional océanien des Territoires pour la gestion durable des écosystèmes), 6 PSSE supplémentaires ont été finalisés (Rimatara, Paea, Tumaraa, Mahina, Hao et Tubuai). Grâce au projet PROTEGE, des outils d’aide et de communication ont également pu être réalisés et un atelier interrégional s’est tenu en avril 2024 pour présenter notamment les PSSE aux maires de Polynésie française.
Le rapport 2023 et les cartes de qualité des eaux de consommation sont disponibles sous les liens suivants :
- Descriptif des ressources en eau et des travaux réalisés et programmés sur les réseaux de distribution par les communes de Polynésie française au 31 décembre 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée à Tahiti et Moorea en 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée aux îles Sous-le-Vent en 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée aux Australes et Marquises en 2023
- Carte présentant la qualité de l’eau distribuée aux Tuamotu-Gambier en 2023
- Qualité des eaux distribuées par les réseaux publics de distribution en 2023
- Qualité des eaux distribuées par les fontaines publiques en 2023
- Qualité des ressources en eau exploitées en 2023
- Evolution de la qualité de l’eau par réseau public de distribution
[ACTUALITÉS]
Qualité bactériologique des eaux de baignade 2022-2023
Dans le cadre de ses missions de protection et de promotion de la santé de la population, le Centre de santé environnementale (CSE), structure rattachée à la Direction de la santé, a poursuivi en 2022 et 2023 son programme de contrôle de la qualité sanitaire des eaux de baignade en mer, aux embouchures de rivières et en eau douce, mis en place depuis 1985.
En 2023, 1559 prélèvements ont été réalisés, dont 218 par la commune de Bora Bora, 61 par la commune de Punaauia et 154 par la communauté de communes Terehēamanu, permettant le classement de 128 points de contrôle sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Nuku Hiva, Hiva Oa et Tubuai.
Les conclusions du rapport sur la qualité des eaux de baignade, pour 2023, sont les suivantes :
- Concernant Tahiti, sur les 62 points en mer classés, 52% sont propres à la baignade, avec une différence de moins en moins marquée entre la zone urbaine (53% propres à la baignade) et la zone rurale (50% propres à la baignade). Quant aux points de baignade en embouchure de rivière, sur les 16 points contrôlés, hormis l’embouchure de la Vaiiha, aucun n’est propre à la baignade déjà depuis 2019. La qualité des eaux de baignade en embouchure de rivière reste très préoccupante que ce soit en zone urbaine (100% en qualité insuffisante depuis 2019) ou rurale (90% de qualité insuffisante en 2023 et 2022). Concernant les eaux douces, la source Vaima reste de qualité excellente.
- Concernant Moorea, sur les 11 points classés en mer en 2023, 55% sont propres à la baignade en 2023. La qualité des eaux de baignade en mer reste très moyenne. Quant aux trois embouchures classées, elles restent impropres à la baignade depuis 2010.
- Concernant Bora Bora, la qualité des eaux de baignade reste excellente.
- Concernant Raiatea, la qualité des eaux en mer reste propre à la baignade. Par contre le dernier point contrôlé en eau douce (rivière Faaroa) reste de qualité insuffisante depuis 2018.
- Concernant Nuku Hiva, sur les 2 points en mer classés en 2022 et 2023, un est de qualité suffisante à bonne et l’autre est de qualité insuffisante. Malgré l’éloignement de l’île, des sources de pollutions impactent donc la qualité de ces eaux.
- Concernant Hiva Oa, la qualité des eaux de baignade reste bonne.
- Concernant Tubuai, la qualité des eaux de baignade reste bonne.
Les principales causes de pollution sont souvent identifiées et la mise en place de mesures correctives et préventives permettrait d’améliorer sensiblement la qualité des eaux de baignade, notamment via la collecte et le traitement de l’ensemble des eaux usées des zones urbanisées par la collectivité publique ou encore par un traitement des eaux pluviales chargées d’apports terrigènes ou autres polluants avant leur rejet.
Le rapport 2022-2023 et la carte de qualité des eaux de baignade sont disponibles sous les liens suivants :
Qualité bactériologique des eaux de baignade 2022-2023
Dans le cadre de ses missions de protection et de promotion de la santé de la population, le Centre de santé environnementale (CSE), structure rattachée à la Direction de la santé, a poursuivi en 2022 et 2023 son programme de contrôle de la qualité sanitaire des eaux de baignade en mer, aux embouchures de rivières et en eau douce, mis en place depuis 1985.
En 2023, 1559 prélèvements ont été réalisés, dont 218 par la commune de Bora Bora, 61 par la commune de Punaauia et 154 par la communauté de communes Terehēamanu, permettant le classement de 128 points de contrôle sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Nuku Hiva, Hiva Oa et Tubuai.
Les conclusions du rapport sur la qualité des eaux de baignade, pour 2023, sont les suivantes :
- Concernant Tahiti, sur les 62 points en mer classés, 52% sont propres à la baignade, avec une différence de moins en moins marquée entre la zone urbaine (53% propres à la baignade) et la zone rurale (50% propres à la baignade). Quant aux points de baignade en embouchure de rivière, sur les 16 points contrôlés, hormis l’embouchure de la Vaiiha, aucun n’est propre à la baignade déjà depuis 2019. La qualité des eaux de baignade en embouchure de rivière reste très préoccupante que ce soit en zone urbaine (100% en qualité insuffisante depuis 2019) ou rurale (90% de qualité insuffisante en 2023 et 2022). Concernant les eaux douces, la source Vaima reste de qualité excellente.
- Concernant Moorea, sur les 11 points classés en mer en 2023, 55% sont propres à la baignade en 2023. La qualité des eaux de baignade en mer reste très moyenne. Quant aux trois embouchures classées, elles restent impropres à la baignade depuis 2010.
- Concernant Bora Bora, la qualité des eaux de baignade reste excellente.
- Concernant Raiatea, la qualité des eaux en mer reste propre à la baignade. Par contre le dernier point contrôlé en eau douce (rivière Faaroa) reste de qualité insuffisante depuis 2018.
- Concernant Nuku Hiva, sur les 2 points en mer classés en 2022 et 2023, un est de qualité suffisante à bonne et l’autre est de qualité insuffisante. Malgré l’éloignement de l’île, des sources de pollutions impactent donc la qualité de ces eaux.
- Concernant Hiva Oa, la qualité des eaux de baignade reste bonne.
- Concernant Tubuai, la qualité des eaux de baignade reste bonne.
Les principales causes de pollution sont souvent identifiées et la mise en place de mesures correctives et préventives permettrait d’améliorer sensiblement la qualité des eaux de baignade, notamment via la collecte et le traitement de l’ensemble des eaux usées des zones urbanisées par la collectivité publique ou encore par un traitement des eaux pluviales chargées d’apports terrigènes ou autres polluants avant leur rejet.
Le rapport 2022-2023 et la carte de qualité des eaux de baignade sont disponibles sous les liens suivants :
[ACTUALITÉS]
Information : vigilance au risque de violation de données personnelles
Le centre de santé scolaire de la Direction de la santé a été victime du vol, dans ses locaux, de plusieurs ordinateurs ayant conduit au vol d’informations sur des personnes suivies par cette structure. De ce fait, des données sont susceptibles d’être divulguées ou utilisées de manière illégale.Cette violation a été notifiée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), comme prévu par l’article 33 du règlement européen sur la protection des données (RGPD).Une plainte a été déposée par la Direction de la santé et des investigations sont en cours.Nous faisons tout notre possible pour identifier les auteurs et limiter les impacts de ce vol que nous déplorons.A ce jour, nous ne sommes pas informés d’une utilisation malveillante des données mais nous ne pouvons pas l’exclure.Nous vous invitons à rester vigilants et à vous méfier des sollicitations inhabituelles ou messages suspects.Vous trouverez des conseils sur Comment réagir en cas de fuite ou violation de données personnelles ?Nous restons à votre disposition pour toute question ou information. Vous pouvez nous contacter à rgpd.dsp@administration.gov.pf.[ACTUALITÉS]
Le Moi(s) Sans Tabac, ça commence le 1er juillet !
Le Ministère de la Santé et la Direction de la santé lancent la deuxième édition de la campagne « Moi(s) Sans Tabac ». Comme lors de sa première édition en 2023, qui avait su réunir plus de 500 participants, celle-ci débutera le 1er juillet prochain.
Le « Moi(s) Sans Tabac » a pour but d’accompagner les fumeurs quotidiens ou occasionnels, désireux d’arrêter de fumer, à relever le défi de se libérer du tabac en 30 jours.
Pour participer à ce challenge collectif, il suffit de s’inscrire sur le site www.aita-tabac.pf et de compléter le formulaire en ligne. Une fois l’inscription validée, le participant reçoit par mail un « bon » lui permettant de retirer son kit « aita tabac » dans une structure de santé de proximité. Ce kit comprend un programme détaillé des 30 jours sans tabac ainsi que divers supports permettant de soutenir les inscrits tout au long de leur sevrage tabagique.Pour rappel, le Moi(s) Sans Tabac vient soutenir la politique définie par le Ministère et la Direction de la santé, qui vise à réduire la consommation de tabac en Polynésie française en s’appuyant sur quatre axes stratégiques :
- Informer et sensibiliser le public sur les avantages de l’arrêt du tabac.
- Former les professionnels de santé au sevrage tabagique pour mieux accompagner les fumeurs dans leur démarche.
- Rendre accessible le sevrage partout en Polynésie en s’assurant que tous aient accès à des ressources et à un soutien pour arrêter de fumer.
- Mettre en place des mesures réglementaires pour encourager les fumeurs à renoncer au tabac.
En complément de cette initiative, les participants au challenge sont invités à rejoindre la page Facebook « Aita Tabac », pensée comme un espace d’échange et de soutien entre les participants.
Au cours du mois de juillet, plusieurs actions seront menées par les agents de la Direction de la santé :
- Tahiti : Taravao, Fare Ora (situé dans l’Hyper U), tous les jours en journée continue : stand de sensibilisation à disposition de la population
- Moorea : Hôpital de Moorea, tous les lundis matin de 7h à 11h30, stand de promotion de santé incluant la possibilité d’échanger sur le sevrage tabagique
- Raiatea : Uturoa, Place To’a Huri Nihi, le samedi 13 juillet 2024 de 8h30 à 12h30 : Tu’aro Ma’ohi pour une « vie sans tabac »
- Marquises : Nuku Hiva, stand itinérant de sensibilisation sur les addictions en général, présent dans différentes vallées.
Pour plus de renseignement :
Mail : communication.dsp@administration.gov.pf
Tel : 40 46 61 79/40 46 61 83Le Moi(s) Sans Tabac, ça commence le 1er juillet !
Le Ministère de la Santé et la Direction de la santé lancent la deuxième édition de la campagne « Moi(s) Sans Tabac ». Comme lors de sa première édition en 2023, qui avait su réunir plus de 500 participants, celle-ci débutera le 1er juillet prochain.
Le « Moi(s) Sans Tabac » a pour but d’accompagner les fumeurs quotidiens ou occasionnels, désireux d’arrêter de fumer, à relever le défi de se libérer du tabac en 30 jours.
Pour participer à ce challenge collectif, il suffit de s’inscrire sur le site www.aita-tabac.pf et de compléter le formulaire en ligne. Une fois l’inscription validée, le participant reçoit par mail un « bon » lui permettant de retirer son kit « aita tabac » dans une structure de santé de proximité. Ce kit comprend un programme détaillé des 30 jours sans tabac ainsi que divers supports permettant de soutenir les inscrits tout au long de leur sevrage tabagique.Pour rappel, le Moi(s) Sans Tabac vient soutenir la politique définie par le Ministère et la Direction de la santé, qui vise à réduire la consommation de tabac en Polynésie française en s’appuyant sur quatre axes stratégiques :
- Informer et sensibiliser le public sur les avantages de l’arrêt du tabac.
- Former les professionnels de santé au sevrage tabagique pour mieux accompagner les fumeurs dans leur démarche.
- Rendre accessible le sevrage partout en Polynésie en s’assurant que tous aient accès à des ressources et à un soutien pour arrêter de fumer.
- Mettre en place des mesures réglementaires pour encourager les fumeurs à renoncer au tabac.
En complément de cette initiative, les participants au challenge sont invités à rejoindre la page Facebook « Aita Tabac », pensée comme un espace d’échange et de soutien entre les participants.
Au cours du mois de juillet, plusieurs actions seront menées par les agents de la Direction de la santé :
- Tahiti : Taravao, Fare Ora (situé dans l’Hyper U), tous les jours en journée continue : stand de sensibilisation à disposition de la population
- Moorea : Hôpital de Moorea, tous les lundis matin de 7h à 11h30, stand de promotion de santé incluant la possibilité d’échanger sur le sevrage tabagique
- Raiatea : Uturoa, Place To’a Huri Nihi, le samedi 13 juillet 2024 de 8h30 à 12h30 : Tu’aro Ma’ohi pour une « vie sans tabac »
- Marquises : Nuku Hiva, stand itinérant de sensibilisation sur les addictions en général, présent dans différentes vallées.
Pour plus de renseignement :
Mail : communication.dsp@administration.gov.pf
Tel : 40 46 61 79/40 46 61 83